Entente - Décret 566/2021
Décret 566/2021
Accord Canada-Ontario sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs, 2021
le présent accord entre en vigueur le 1er jour de juin 2021.
entre
sa majesté la reine du chef du canada (canada)
Représentée par
L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’environnement et du Changement climatique (et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada)
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
L’honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et Océans
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé
L’honorable Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles
L’honorable Omar Alghabra, ministre des Transports
et
sa majesté la reine du chef de l'ontario (ontario)
Représentée par
L’honorable Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
L’honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts
L’honorable Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Attendu que le Canada et l'Ontario (les parties) confirment que le présent Accord est guidé par la vision commune d'un écosystème des Grands Lacs sain, prospère et durable pour les générations actuelles et futures;
Et attendu que les parties reconnaissent qu'environ 33 % de la population du Canada vit dans la région des Grands Lacs et comprend sept des vingt plus grandes villes canadiennes, et que les sources municipales autour des Grands Lacs fournissent directement de l'eau potable à plus de 60 % des résidents de l'Ontario;
Et attendu que les parties reconnaissent que la région des Grands Lacs joue un rôle essentiel dans la vie physique, sociale et économique du Canada, avec le bassin des Grand Lacs de l’Ontario soutenant près de 40 % du produit intérieur brut du Canada, environ 25 % de la production agricole du Canada, et plus de la moitié des activités de fabrication du Canada;
Et attendu que l'activité économique, l'exploitation des ressources et l'innovation durables et responsables sur le plan environnemental sont essentielles à la prospérité à long terme de la région des Grands Lacs;
Et attendu que les parties reconnaissent que les Grands Lacs renferment environ 20% des eaux douces de surface de la planète, et que moins de 1 % de l'eau est renouvelée chaque année par les précipitations;
Et attendu que les parties partagent la compétence relative aux Grands Lacs, ce qui rend la coordination et la coopération essentielles à leur restauration, à leur protection et à leur conservation, et reconnaissent que l'Ontario est la région détenant la plus grande ligne de côte autour des Grands Lacs;
Et attendu que les parties reconnaissent que les Grands Lacs sont importants sur le plan écologique, grâce à leur diversité biologique exceptionnelle et aux activités de pêche importantes qui y ont lieu;
Et attendu que les parties reconnaissent l'étroite relation entre la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et la santé humaine, et les effets positifs de l'utilisation et de la jouissance de Grands Lacs sains sur les personnes et les collectivités;
Et attendu que depuis 1971, les parties ont travaillé en collaboration par l'entremise d'une série d'Accords Canada-Ontario qui ont guidé leurs efforts pour améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des lacs, et ont contribué à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
Et attendu que les efforts de la collectivité des Grands Lacs contribuent à la restauration, à la protection et à la conservation des Grands Lacs;
Et attendu que le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la réconciliation avec les peuples des Premières Nations et les Métis grâce à des relations renouvelées de nations à nations, de gouvernement à gouvernement, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat;
Et attendu que les Premières Nations et les Métis vivant dans le bassin des Grands Lacs estiment que les Grands Lacs revêtent une importance spirituelle et culturelle pour leur communauté;
Et attendu que le savoir écologique traditionnel peut contribuer aux efforts restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs, et les parties s'efforcent de tenir compte de ces connaissances dans tous les cas où elles ont été proposées;
Et attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
Et attendu que les Premières Nations de l'Ontario ont adopté une Déclaration sur l'eau qui exprime leurs objectifs en matière de protection de l'eau;
Et attendu que les parties reconnaissent que des progrès ont été réalisés dans les Grands Lacs en réduisant les rejets de polluants nocifs, en améliorant et en protégeant l'habitat des poissons et de la faune, en restaurant un certain nombre de secteurs préoccupants, et en favorisant un sentiment d'intendance;
Et attendu que les parties reconnaissent que, malgré les progrès réalisés, les Grands Lacs présentent actuellement des symptômes de stress en raison des activités humaines entreprises au sein du bassin et ailleurs dans le monde;
Et attendu que les parties reconnaissent la nécessité de renforcer les efforts pour gérer les menaces récurrentes et nouvelles qui pèsent sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, y compris les espèces aquatiques envahissantes, les quantités excessives d'éléments nutritifs, les polluants nocifs, les rejets provenant des bateaux, les changements climatiques et la perte d'habitats et d'espèces;
Et attendu que les Parties reconnaissent que la science est le fondement d'une compréhension commune de l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux des Grands Lacs et d'une prise de décisions et de mesures efficaces en ce qui concerne les Grands Lacs;
Et attendu que les parties reconnaissent qu'en plus des eaux au large des côtes, les zones littorales doivent être restaurées, protégées et conservées parce qu'elles sont la principale source d'eau potable des collectivités, parce que la plupart des activités commerciales et de loisirs humaines y ont lieu, et parce qu'elles constituent le lien écologique crucial entre les bassins versants et les eaux libres des Grands Lacs;
Et attendu que les parties reconnaissent que la vaste majorité des infrastructures publiques de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées au Canada appartiennent aux gouvernements provinciaux, territoriaux ou municipaux, lesquels en assurent également l'exploitation et l'entretien, et qu'il incombe donc aussi à ces gouvernements de déterminer les mesures et les projets prioritaires dans leur compétence;
Et attendu que les parties reconnaissent que le Règlement fédéral sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées de 2012 établit des normes nationales sur la qualité des effluents pour le traitement secondaire des eaux usées au Canada;
Et attendu que les parties reconnaissent que la restauration et l'amélioration de la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l’écosystème en s'attaquant aux menaces individuelles ne peuvent être atteintes de façon isolée mais qu'elles découleront plutôt de l'application d'une approche écosystémique traitant de façon individuelle et cumulative toutes les sources de stress pour l'écosystème des Grands Lacs;
Et attendu que les parties reconnaissent que le Canada est responsable de la réalisation de ses engagements binationaux selon l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, et que l'Ontario accepte de l'appuyer la façon mentionnée dans le présent Accord;
Et attendu que les parties reconnaissent que la qualité de l'eau des Grands Lacs peut influencer la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent en aval de la frontière internationale;
Et attendu que les parties confirment leur engagement à travailler ensemble afin de mettre en œuvre l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de faire progresser la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et les mesures des Grands Lacs dans le plan environnemental de l’Ontario en respectant la vision et les objectifs du présent Accord;
Et attendu que les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble, et à mobiliser la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs pour les générations actuelles et futures.
en conséquence de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :
articles
article i
définitions
Dans le présent Accord :
- « Accord » désigne l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs (2021), y compris les annexes.
- « Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs » désigne le Protocole relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012 signé entre le Canada et les États-Unis.
- « Bonne gouvernance » désigne le fait de suivre un processus décisionnel basé sur la participation du public, la transparence et la responsabilité.
- « Collectivité des Grands Lacs » désigne les Premières nations et les Métis; les administrations municipales; les offices de protection de la nature; les organisations non gouvernementales; le milieu scientifique; les activités industrielles, agricoles, récréatives, touristiques et autres; et les membres du grand public, ayant un intérêt pour les questions sur les Grands Lacs.
- « Écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne l'interaction des éléments de l'air, du sol, de l'eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, et tous les ruisseaux, rivières, lacs et autres nappes d'eau, y compris les eaux souterraines, entrant dans le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent à l'endroit où celui-ci devient une frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
- « Grands Lacs » désigne les eaux des lacs Supérieur, Huron, Michigan, Érié et Ontario ainsi que les réseaux hydrographiques reliés de la rivière St. Marys, de la rivière Sainte-Claire, y compris le lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit, de la rivière Niagara et du fleuve Saint- Laurent, à la frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, y compris toutes les eaux libres et littorales.
- « Plan environnemental de l’Ontario » désigne l'ébauche du document de 2018 intitulé Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario, tel qu'affiché par le gouvernement de l'Ontario ou son successeur.
- Les « Polluants nocifs » désigne des substances chimiques ou des agents pathogènes qui ont un effet nuisible sur la santé humaine ou écologique, notamment les produits chimiques préoccupants ou les substances nouvellement préoccupantes.
- « Produits chimiques préoccupants » désigne les produits chimiques considérés par le Canada et l'Ontario comme préoccupants pour la santé humaine ou environnementale dans le bassin des Grands Lacs et qui doivent être traités en priorité pour l'application de mesures précises. Un produit chimique préoccupant pourrait être mis en candidature en vertu de l'annexe sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de l'Accord Canada- États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
- « Prolifération d’algues nuisibles » désigne des proliférations d’algues telles que la Cladophora qui détériorent l’habitat des poissons et de la faune, obstruent les tuyaux de prise d’eau et souillent les berges et le matériel de pêche, mais qui ne produisent pas de toxines;
- « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » désigne la version actuelle du document intitulé « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » préparé en vertu de l'article 5 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs et publié par le gouvernement de l'Ontario;
- « Sels de voirie » signifie des substances utilisées pour le dégivrage et à d’autres fins qui contiennent des sels inorganiques de chlorure avec ou sans sels de ferrocyanure;
- « Prolifération d’algues toxiques », aussi appelée prolifération d’algues bleues ou de cyanobactéries, signifie un type de bactéries qui réalisent une photosynthèse et qui peuvent être influencées par des concentrations excessives de phosphore. Les cyanobactéries peuvent produire des substances toxiques appelées cyanotoxines susceptibles de nuire à l’homme et à d’autres organismes.
article ii
objectif
- L'objectif du présent Accord est de restaurer, de protéger et de conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin de concrétiser la vision d'une région saine, prospère et durable pour les générations actuelles et futures.
- Les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d'autres en collaboration, de manière coordonnée et intégrée dans la région des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance, en vue de la réalisation de la vision.
- Pour atteindre la vision, l'Accord :
- établit les principes qui guideront les mesures des parties;
- décrit l'élaboration d'annexes pour répondre aux questions environnementales existantes ou émergentes;
- met en place des ententes administratives pour une gestion efficace et efficiente de l'Accord;
- établit des priorités, objectifs, résultats et engagements communs de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs;
- En définissant une vision pour les Grands Lacs, des résultats précis, et l'engagement à agir des parties, le présent Accord vise à donner un élan aux efforts plus vastes et à faciliter les ententes relatives à la collaboration et les mesures collectives parmi toutes les personnes et organisations ayant un intérêt pour la région des Grands Lacs.
- La mise en œuvre du présent Accord contribuera à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et le Plan environnemental de l’Ontario.
article iii
principes
Les principes suivants guideront les actions des parties en vertu de l'Accord :
- Collaboration, coopération et engagement : s'assurer que le processus de prise de décision fournit à la collectivité des Grands Lacs des occasions intéressantes lui permettant de discuter, de donner des conseils et de participer directement aux activités appuyant l'Accord, et tient compte des opinions et des conseils provenant de la collectivité des Grands Lacs.
- Communication : faire en sorte que des méthodes efficaces sont utilisées pour informer le public de l’importance des Grands Lacs, des problèmes environnementaux de plus en plus complexes touchant les Grands Lacs et des efforts continus visant à surmonter les problèmes, et pour encourager les mesures collaboratives et individuelles et l'intendance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs.
- Conservation : promouvoir la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources afin de soutenir l’intégrité physique, chimique et biologique des Grands Lacs.
- Durabilité : prendre en compte les demandes sociales, économiques et environnementales pour équilibrer les besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
- Échange libre de renseignements : recueillir des données une fois, le plus près possible de la source, le plus efficacement possible et partager l'information avec d'autres.
- Effets cumulatifs : prendre en compte les effets combinés des mesures individuelles sur l'environnement.
- Gain net : concevoir des mesures de développement humain et de gestion afin de maximiser les avantages environnementaux plutôt que de viser uniquement la minimisation des coûts environnementaux.
- Gestion adaptative : mener des activités avec ouverture et innovation et dans une perspective d'amélioration continue pour assurer une gestion efficace de l'Accord.
- Gestion fondée sur la science : donner des conseils pour établir des priorités, des politiques et des programmes de gestion fondés sur les meilleures données scientifiques, recherches et connaissances disponibles, y compris les connaissances écologiques traditionnelles lorsqu'elles sont offertes.
- Pollueur-payeur : reconnaître que le pollueur doit assumer le coût de la pollution.
- Premières Nations et Métis : leur identité, leur culture, leurs intérêts, leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles seront pris en considération dans la restauration, la protection et la conservation de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
- Prévention de la pollution : utiliser des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des substances ou des formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.
- Principe de precaution : en cas de risques de dommages environnementaux graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
- La quasi-élimination - adopter le principe de la quasi-élimination des produits chimiques préoccupants, le cas échéant;
- Rejet nul : appliquer l'objectif de ne plus rejeter de produits chimiques préoccupants, le cas échéant.
- Responsabilisation – rendre des comptes aux citoyens en définissant des résultats et des engagements clairs pour cet Accord et en fournissant des rapports réguliers;
article iv
annexes
- Les parties conviennent d'élaborer et de mettre en œuvre des annexes qui mettent l'accent sur les enjeux environnementaux qui sont une priorité pour les parties et bénéficieront d'une action coordonnée et coopérative.
- Dans le cadre de cet Accord, le Canada et l'Ontario fournissent des résultats et des engagements précis concernant leur travail ensemble et avec la collectivité des Grands Lacs, sous réserve d'une bonne gouvernance, pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Ils sont traités dans les treize annexes, qui sont regroupées en cinq priorités :
Protection des eaux
- Éléments nutritifs
- Polluants nocifs
- Eaux usées et eaux de ruissellement
- Rejets provenant des bateaux
Amélioration des zones littorales
- Secteurs préoccupants
- Aménagement panlacustre
Protection de l’habitat et des espèces
- Espèces aquatiques envahissantes
- Habitat et espèces
Amélioration de la compréhension et de l’adaptation
- Qualité des eaux souterraines
- Résilience et répercussions des changements climatiques
Collectivités – De la sensibilisation aux mesures
- De la sensibilisation aux mesures
- Les Métis et les Grands Lacs
- Les Premières Nations et les Grands Lacs
- Chaque annexe précise :
- un préambule introduisant l'objet de l'annexe et précisant ce que les deux parties s'efforceront de réaliser à long terme;
- les résultats pour les Grands Lacs propres à l'objet de l'annexe et les engagements que chaque partie prendra conjointement ou séparément, comme spécifié pour la durée de l'annexe afin d'obtenir les résultats escomptés.
- Les annexes peuvent être élaborées en tout temps et entrent en vigueur lorsque les parties apposent leur signature. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance selon le cas lors de l'élaboration d'annexes.
article v
administration de l’accord
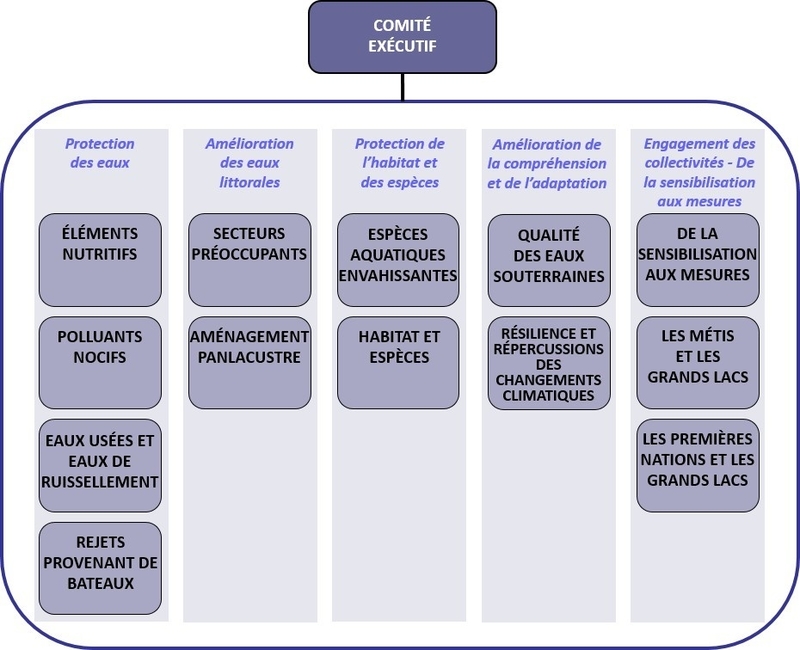
Ce graphique illustre les treize annexes de l'Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, regroupées en cinq secteurs prioritaires. La supervision de l'accord est confiée à son comité exécutif. Priorités : Protection des eaux, Amélioration des eaux littorales, Protection de l'habitat et des espèces, Amélioration de la compréhension et de l'adaptation, Engagement des collectivités - De la sensibilisation aux mesures. Annexes : Éléments nutritifs, Polluants nocifs, Eaux usées et eaux de ruissellement, Rejets provenant des bateaux, Secteurs préoccupants, Aménagement panlacustre, Espèces aquatiques envahissantes, Habitats et espèces, Qualité des eaux souterraines, Résilience et répercussions des changements climatiques, De la sensibilisation aux mesures, Les Métis et les Grands Lacs, Les Premières Nations et les Grands Lacs.
comité exécutif de l'accord canada-ontario
- La supervision de l'Accord sera confiée à un Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario. Le Comité sera composé des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux régionaux ou des représentants régionaux les plus élevés provenant de tous les ministères et organismes des parties qui ont la responsabilité de diriger ou de soutenir un ou plusieurs engagements pris dans les annexes. Le Comité sera coprésidé par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- Le Canada invitera les membres ontariens du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario à participer au Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs en vertu de l'article 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario mènera des discussions avant les réunions du Comité exécutif binational des Grands Lacs afin d'examiner et de donner des conseils sur les questions qui seront soulevées au cours des réunions.
- Le Canada invitera l'Ontario pour participer à des sous-comités propres aux annexes relevant du Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs, au besoin, afin d'aider à la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
- Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :
- l'établissement de priorités sur une base annuelle afin de coordonner la mise en œuvre de l'Accord;
- la réalisation d'évaluations annuelles de l'Accord et la recommandation de modifications ou de mesures pour faciliter les progrès, au besoin;
- la facilitation de discussions stratégiques sur des questions comme les infrastructures, la science et l'innovation entre les signataires et les ministères, départements et organismes non signataires des parties et d'autres intervenants pour assurer la coordination efficace des mesures;
- la supervision de l’élaboration, de la modification et de la mise en œuvre des Annexes;
- la supervision de la communication en temps opportun des communications et des rapports d'étape publics, tel qu’il est décrit à l’Article VII, à la collectivité des Grands Lacs et veiller à ce qu’il y ait des possibilités d’engagement et d’amélioration de la collaboration à l’égard des Grands Lacs;
- l'organisation de tables rondes, le cas échéant, auxquelles seraient invités des représentants des organismes ou régions nationaux pertinents des Grands Lacs qui s'intéressent à la gestion des Grands Lacs et des représentants de la collectivité des Grands Lacs, y compris les intérêts en aval le long du fleuve Saint-Laurent;
- la mise au point de positions communes pour représenter les intérêts des Canadiens et participer à des initiatives de coopération avec les organismes des États-Unis et la Commission mixte internationale;
RESPONSABLES DES ANNEXES
- Afin de gérer la mise en œuvre de chaque annexe, les parties désigneront des responsables fédéraux-provinciaux pour :
- superviser la coordination, la coopération et l'intégration propres à l'annexe des activités, y compris la mise en place d'équipes relatives à l'annexe, au besoin;
- identifier les services, ministères et organismes chefs de file et de soutien pour les engagements au titre de cette annexe;
- coordonner la mise en œuvre des engagements relatifs à l’Accord, dont des projets pour atteindre ces engagements et mettre en place une évaluation annuelle des progrès. Tous les efforts nécessaires seront déployés afin d'assurer une approche coordonnée et coopérative en optimisant l'intégration des activités des départements, ministères et organismes participants et des autres partenaires de mise en œuvre;
- recommander un plan d'action pour le Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario ou aux coprésidents du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario lorsque plus d'autorité ou une orientation stratégique est requise pour atteindre les objectifs, les résultats et les engagements de l'Accord;
- s’assurer que des possibilités suffisantes d'engagement, de participation, de mesures coordonnées et de collaboration avec la collectivité des Grands Lacs sont disponibles, au besoin, pour examiner les questions émergentes, donner des conseils sur les projets et exécuter les résultats et les engagements énoncés dans l'annexe.
- examiner chaque année les priorités scientifiques énoncées dans les annexes et tenir des tables rondes, au besoin, pour appuyer les résultats et les engagements de l'Accord fondés sur des données scientifiques;
- faire participer les collectivités des Premières nations et des Métis à l'exécution des engagements de l'annexe, au besoin.
article vi
science
Les parties conviennent de mener, de maintenir, de cibler et de coordonner des activités, des programmes, des données, des renseignements, soutenir les connaissances écologiques traditionnelles et, si offertes, considérer ces connaissances dans les prises de décision afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'Accord.
article vii
rapport
Les parties conviennent de rendre publics les rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l'Accord, en temps opportun et de manière transparente : Le Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et l'Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs de l'Ontario et, conjointement, par l’entremise des rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario.
article viii
ressources
Les parties s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l'Accord et les annexes en vertu de celui-ci, assujetti à l'octroi d'une affectation à de telles fins au Parlement ou selon la législature, selon le cas, pour l'exercice financier pertinent. Les parties acceptent de créer des possibilités pour que d'autres intervenants puissent contribuer, au besoin, à l'atteinte de l'objectif de l'Accord.
article ix
notification
- Avant de procéder à toute modification à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, le Canada mènera une consultation avec l'Ontario.
- Avant d'entreprendre toute activité avec les États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur cet Accord, le Canada devra aviser l'Ontario.
- Avant de conclure un accord avec des États des États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur le présent Accord, l'Ontario informera le Canada.
- Les parties conviennent de continuer de coopérer à la prévision, à la prévention et à la gestion des menaces pesant sur les Grands Lacs. Les parties conviennent de faciliter l'échange de renseignements au moyen des mécanismes existants afin de fournir un avis de toute activité proposée pouvant avoir une incidence importante sur les eaux des Grands Lacs.
article x
modification de l’accord
L'Accord peut être modifié par les parties en tout temps. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs, au besoin, en cas de modification de l'Accord. Une modification doit être confirmée par un échange de lettres entre les parties établissant la modification et sa date d'entrée en vigueur.
article xi
prévention des conflits
- Les parties s'engagent à travailler en collaboration pour prévenir et résoudre les litiges concernant la gestion de l'Accord et la réalisation des obligations énoncées dans les annexes.
- Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario déploiera tous les efforts raisonnables pour résoudre les litiges en vertu du présent Accord.
- Si le litige dans le cadre de l'Accord n'est pas résolu par le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario, l'une ou l'autre partie peut fournir un avis écrit à l'autre partie de la question en litige ainsi que les renseignements et les documents connexes nécessitant de plus amples efforts de la part des parties pour résoudre le problème. Dans ce cas, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis, les parties se rencontreront afin de discuter du litige en faisant preuve de coopération et de collaboration. Si le litige n'est pas résolu dans les 60 jours suivant la réunion, ou d'une période plus longue pouvant être convenue par les parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie de tenir lieu de médiateur en lien avec la résolution du litige.
article xii
entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le 1 juin 2021, et restera en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au 31 mai 2021. L'Accord peut prendre fin plus tôt si l'une des parties en informe l'autre partie au moins six mois à l'avance par le biais d'un avis écrit.
article xiii
respect de la loi
- Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des parties en ce qui a trait à l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada.
- Les parties reconnaissent que les obligations dans le présent Accord sont soumises aux lois applicables du Canada et de l'Ontario.
original signé par
au nom de sa majesté la reine du chef du canada
Ministre de l’Environnement (et ministre responsable de Parcs Canada)
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Ministre des Pêches et des Océans
Ministre de la Santé
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Transports
au nom de sa majesté la reine du chef de l’ontario
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
priorité – protection des eaux
Cette priorité est axée sur la compréhension et la réduction de l'excédent d'éléments nutritifs, la réduction ou l'élimination des rejets de polluants nocifs, l’amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, et la protection des Grands Lacs contre les rejets provenant des bateaux, dans le but de protéger la santé et le bien-être de la population humaine et des écosystèmes aquatiques. L'eau propre constitue la base de la santé de l’écosystème des Grands Lacs, mais est menacée par diverses sources de pollution, dont les effets dommageables sont exacerbés par les changements climatiques. Afin de répondre à ces enjeux, cette priorité comprend les annexes sur les éléments nutritifs, les polluants nocifs et les rejets provenant des bateaux.
annexe 1 : éléments nutritifs
La présente annexe vise à traiter la question de l'excès d'éléments nutritifs et à réduire les efflorescences algues nuisibles et les zones d'hypoxie.
Il y a toujours un besoin urgent de répondre de manière coordonnée et stratégique aux problèmes de gestion des éléments nutritifs dans les Grands Lacs, et en particulier dans le lac Érié. Pendant les années 1970 et 1980, les efforts concertés visant à réduire la quantité de phosphore ont réussi et les conditions du lac se sont améliorées. En 1985, les charges de phosphore dans les Grands Lacs étaient égales ou inférieures aux cibles définies en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Toutefois, depuis le milieu des années 1990, il y a eu une recrudescence des proliférations d’algues dans le lac Érié et dans les régions riveraines des lacs Huron et Ontario, et des proliférations d'algues commencent aussi à apparaître dans le lac Supérieur.
Les raisons de la présence d'efflorescences d’algues sont maintenant plus complexes que dans les dernières décennies. L'introduction d'espèces envahissantes telles que la moule zébrée, la moule quagga et le gobie à taches noires, des changements dans les systèmes de production agricole, l'augmentation de l'urbanisation et les changements climatiques sont tous des facteurs qui y contribuent. De nouvelles solutions sont requises.
Les niveaux actuels d'éléments nutritifs dans les Grands Lacs compromettent l'utilisation par l'homme et entraînent également des effets nocifs sur le fonctionnement des écosystèmes. La présente annexe reconnaît que la poursuite de la santé environnementale, sociale et économique du bassin des Grands Lacs exige une gestion efficace des éléments nutritifs provenant des activités humaines. Dans le cadre de l’Accord de 2014, le Canada et l’Ontario ont collaboré avec plusieurs partenaires pour fixer des cibles de réduction de la charge de phosphore dans le lac Érié et élaborer le Plan d’action Canada–Ontario pour le lac Érié afin d’atteindre ces cibles. La présente annexe misera sur ces réalisations en répondant à la nécessité d'une meilleure compréhension des problèmes liés aux éléments nutritifs tout en continuant d'élaborer et de promouvoir des mesures visant à améliorer la gestion des éléments nutritifs.
Les mesures prises pour comprendre et régler les problèmes liés à la qualité des eaux littorales, à la santé de l'écosystème aquatique et à la prolifération des algues nuisibles continueront d'être appliquées pour tous les Grands Lacs. L'accent continue d'être mis sur le lac Érié et sur la collaboration avec nos partenaires pour mettre en œuvre le Plan d'action pour le lac Érié. Les données scientifiques, les connaissances et les approches stratégiques acquises dans le lac Érié commenceront à être appliquées au lac Ontario, le cas échéant.
Un certain nombre d'initiatives complémentaires contribuent à l'objectif de réduction des efflorescences algues nuisibles et d’hypoxie dans les Grands Lacs. Celles-ci comprennent les investissements fédéraux et provinciaux dans la recherche et la surveillance relatives aux éléments nutritifs; l'infrastructure verte, les technologies de traitement des eaux usées et les mises à niveaux des installations abordées dans l’annexe sur les eaux usées et les eaux de ruissellement; et des améliorations dans l'utilisation des terres urbaines et rurales et des pratiques de gestion des terres. La présente annexe, qui implique de travailler avec la collectivité des Grands Lacs, vise l'atteinte de l'objectif à long terme relatif à l'utilisation durable des éléments nutritifs pour la santé et la productivité continues de l'écosystème des Grands Lacs et de l'économie. Des engagements précis sont fournis afin d'améliorer la compréhension scientifique de la dynamique des éléments nutritifs, d'élaborer des cibles et des plans d'action en matière de phosphore, et d’accroître l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs agricoles conformément à la santé de l'écosystème et de l'économie des Grands Lacs. Les engagements pris dans d'autres annexes, y compris les eaux usées et les eaux de ruissellement, l'aménagement panlacustre, la résilience et les répercussions des changements climatiques, les secteurs préoccupants et les polluants nocifs, contribuent également à la réduction des quantités excessives d'éléments nutritifs.
Résultat 1 – Élaboration et mise en œuvre de plans d’action et d’approches visant à atteindre les objectifs de réduction du phosphore dans le lac Érié.
Le Canada et l'Ontario :
- Se réuniront annuellement pour discuter des priorités visant à faire progresser la réduction du phosphore, de la surveillance et des rapports, et des stratégies pour maximiser la collaboration et la coordination;
- Travailleront avec des partenaires pour mettre en œuvre les mesures du Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié;
- S'appuieront sur les structures de gouvernance existantes pour assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre du Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié;
- Rendront des comptes tous les ans sur les charges de phosphore du lac Érié sur une base binationale et nationale;
- Évalueront en 2023 les progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles de réduction du phosphore et les mesures énoncées dans le Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié et en feront rapport;
- Appuieront la mise en œuvre d'approches binationales et nationales de gestion adaptative pour assurer une gestion efficace des éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié;
- Appuieront l'élaboration d’ici 2022 et la mise en œuvre de plans de gestion du phosphore pour les bassins versants prioritaires du lac Érié, y compris les affluents de la rivière Thames et de la région de Leamington, et les secteurs clés;
- Mettront en œuvre des programmes de financement pour appuyer les projets qui démontrent l'efficacité ou une adoption accrue des pratiques de gestion bénéfiques nouvelles ou existantes et des approches novatrices pour réduire les charges de phosphore dans le lac Érié et communiquer les résultats afin de promouvoir leur adoption à grande échelle.
Résultat 2 – Établissement d'objectifs de concentration et de charge en phosphore pour les affluents prioritaires, les eaux littorales et extracôtières des lacs Érié et Ontario.
Le Canada et l'Ontario :
- Élaboreront et examiner ou réviser, au besoin, les indicateurs nutritionnels et biotiques dans le cas du lac Érié pour la santé des écosystèmes aquatiques afin de s'assurer qu'ils appuient et mesurent les progrès vers les résultats indiqués dans la présente annexe;
- Établiront des objectifs supplémentaires de charge des affluents du lac Érié, s'il y a lieu.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- De réévaluer, en collaboration avec les États-Unis, la viabilité de l'établissement d'objectifs scientifiques numériques de réduction des charges de phosphore dans le bassin est du lac Érié et établir un objectif, le cas échéant; et
- De synthétiser, examiner et évaluer, en collaboration avec les États-Unis, la pertinence de la surveillance, de la recherche et de la modélisation du lac Ontario pour calculer les charges de phosphore dans le lac Ontario et établir des cibles binationales en matière de phosphore dans le lac Ontario.
Résultat 3 –Évaluer et gérer le lac Ontario du point de vue des éléments nutritifs afin de réduire la prolifération d’algues nuisibles et toxiques et de maintenir un système trophique panlacustre sain.
Le Canada et l'Ontario :
- Identifieront et feront la promotion des mesures précoces pouvant être prises pour réduire les charges d'éléments nutritifs dans le lac Ontario, au besoin;
- Élaboreront une stratégie canadienne sur les éléments nutritifs pour le lac Ontario afin de lutter contre la prolifération d’algues nuisibles et toxiques, y compris dans les secteurs préoccupants et d'autres secteurs littoraux.
Résultat 4 –Meilleures compréhension, élaboration et adoption de pratiques et de technologies visant à réduire le risque de perte excessive d'éléments nutritifs dans la production agricole, conformément à un secteur agricole durable et concurrentiel.
Le Canada et l’Ontario :
- Rechercheront et mettront au point des approches et des technologies novatrices et étudieront l'efficacité et la valeur économique des meilleures pratiques et pratiques bénéfiques agricoles de gestion, nouvelles et existantes, pour améliorer la gestion des éléments nutritifs, des sols et de l'eau dans la production agricole qui permettra d’améliorer la qualité de l’eau;
- Mèneront des recherches à l'échelle du sous-bassin hydrographique et à l'échelle du terrain pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre continues d'approches et de technologies visant à réduire les pertes de phosphore excédentaire d'origine agricole;
- Continueront à améliorer les modèles et les outils permettant d'évaluer le risque de pertes de phosphore excédentaire dans les paysages agricoles;
- Appuieront le leadership du secteur agroalimentaire dans la sensibilisation et l'adoption accrue de la planification environnementale à la ferme et des pratiques de gestion bénéfiques en fournissant des outils, des possibilités d'éducation et de démonstration, des conseils techniques et du financement.
L’Ontario :
- Collaborera avec les partenaires pour la santé des sols afin de prendre des mesures, dans le cadre de la Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l'Ontario, pour favoriser la préservation et la création de sols sains, et aider à réduire l'appauvrissement des sols agricoles en éléments nutritifs en acquérant des connaissances et des compétences dans le domaine de la santé des sols, en améliorant les modes de détermination de la santé des sols, en favorisant l'adoption de pratiques propices à la santé des sols et en appuyant les outils de prise de décisions.
Résultat 5 – Améliorer la compréhension des sources, de la dynamique et du transport, au besoin, des éléments nutritifs et du rôle qu'ils jouent dans la prolifération d'algues et de l'hypoxie dans les Grands Lacs, en particulier dans les lacs Érié et Ontario.
Le Canada et l’Ontario :
- Appuieront la surveillance et les mesures visant à améliorer la compréhension de la dynamique, des concentrations et des charges d'éléments nutritifs, y compris les formes et le caractère saisonnier, pour les principaux affluents des lacs Érié et Ontario;
- Surveilleront les débits de certains affluents des Grands Lacs afin de calculer les charges en éléments nutritifs, et en rendront compte;
- Estimeront et rendront compte sur les charges saisonnières et annuelles de phosphore provenant de sources canadiennes dans les lacs Érié et Ontario, selon les données disponibles;
- Amélioreront la compréhension, pour certains affluents, sur la manière dont les activités des différents secteurs et les caractéristiques saisonnières influent sur la qualité de l'eau des rives des lacs Érié et Ontario, y compris les sources ponctuelles et non ponctuelles, et le rôle des déversoirs d'eaux usées et des dérivations;
- Amélioreront l'information sur l'utilisation des terres, des sols et des pratiques de gestion concernant l'excès de phosphore dans les Grands Lacs;
- Mèneront des programmes de surveillance à long terme de la qualité de l'eau et de l'état des algues dans le lac, y compris la surveillance de Cladophora dans des sites sentinelles des lacs Érié et Ontario;
- Déploieront des systèmes de surveillance dans les lacs Érié et en Ontario pour surveiller les niveaux d'oxygène, la température et les pigments d'algues afin de suivre l'hypoxie et la stratification des lacs;
- Étudieront la contribution des caractéristiques du patrimoine naturel à la réduction de l'excès de phosphore dans les paysages ruraux et agricoles;
- Amélioreront la connaissance et la compréhension des liens de cause à effet entre des facteurs tels que la durée, l'intensité, la fréquence et le moment des tempêtes, les espèces aquatiques envahissantes, l'utilisation et la gestion des terres, les processus hydrologiques, le cycle interne des éléments nutritifs, production d’hypoxie et prolifération d'algues nuisibles et toxiques dans les Grands Lacs;
- Mèneront des travaux de recherche et de modélisation pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux proliférations de Cladophora dans les Grands Lacs et leurs effets sur la qualité de l'eau, la santé des écosystèmes et l'utilisation humaine.
Le Canada :
- Mènera des programmes de surveillance à long terme dans les lacs permettant le suivi des communautés d’algues et des toxines associées;
- Mettra au point et appliquera des technologies de télédétection pour détecter et prévoir les proliférations de cyanobactéries dans les Grands Lacs;
- Appliquera des modèles intégrés des écosystèmes des lacs et des bassins versants, en tenant compte des changements climatiques, le cas échéant, pour appuyer la prise de décisions par une gestion adaptative;
- Élaborera, appliquera et opérationnalisera des modèles de bassins hydrographiques appropriés pour appuyer la prise de décisions pour certains bassins versants des lacs Érié et Ontario;
- Étudiera l'influence des changements climatiques sur les Grands Lacs, y compris les éléments nutritifs et les conditions dans les lacs, par le déploiement de bouées climatiques à long terme.
L’Ontario :
- Étendra, pour le lac Ontario, la couverture saisonnière de la surveillance de la qualité de l'eau au lac et à l’intérieur de celui-ci afin de mieux comprendre les impacts des événements extrêmes et des événements qui surviennent en hiver sur la croissance des algues.
annexe 2 : polluants nocifs
L'objectif de la présente annexe est de guider les mesures de coopération et de coordination visant à réduire ou à éliminer les rejets de polluants nocifs dans le bassin des Grands Lacs.
Depuis plus de 50 ans, le Canada et l'Ontario travaillent de concert dans le but de réduire ou d'éliminer le rejet de polluants nocifs dans le bassin des Grands Lacs.
Il y a eu des réalisations importantes dans la réduction de la présence d'un certain nombre de produits chimiques dans le bassin des Grands Lacs, y compris une réduction de plus de 90 % des rejets canadiens de mercure, de dioxines et de furannes et une réduction de plus de 90 % de la quantité de BPC à forte concentration entreposée en Ontario. Les concentrations de ces produits chimiques sont maintenant beaucoup plus faibles dans les sédiments, les eaux côtières et les poissons des Grands Lacs qu'elles ne l'étaient au cours des décennies précédentes.
Malgré ces succès, des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour mieux comprendre les sources potentielles et l'impact de certains de ces produits chimiques sur l'écosystème des Grands Lacs et, le cas échéant, pour prendre des mesures nouvelles ou additionnelles de gestion des risques. De plus, il est important de s'attaquer à d'autres produits chimiques qui sont utilisés et rejetés dans le bassin des Grands Lacs et dont on sait, ou dont on soupçonne, qu'ils présentent un risque accru pour la santé humaine ou l'environnement. Les industries, les institutions, les exploitations agricoles et les résidences sont parmi les sources de produits chimiques dans nos eaux. Certains de ces polluants passent par les installations municipales de traitement des eaux usées, qui sont principalement conçues pour traiter les déchets humains en réduisant les éléments nutritifs et les agents pathogènes, mais qui sont peut-être moins en mesure de traiter efficacement la vaste gamme de produits chimiques rejetés dans les égouts. La présente annexe traite des rejets de polluants nocifs provenant de sources individuelles - ceux qui sont rejetés dans les réseaux d'égout et ceux qui sont rejetés directement dans les affluents et les lacs - et complète les travaux menés en vertu de l'annexe sur les eaux usées et les eaux de ruissellement, pour améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement municipales.
Le Canada et l'Ontario participent activement à des programmes et à des initiatives conçus pour évaluer et gérer les risques que posent certains produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement. Les initiatives fédérales comprennent le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), qui évalue et gère les risques posés par les produits chimiques conformément aux lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les pêches. Les efforts internationaux déployés dans le cadre du PGPC, comme la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, peuvent contribuer à réduire les rejets de produits chimiques préoccupants provenant de sources situées à l'extérieur du bassin des Grands Lacs. Les initiatives provinciales visant à protéger la santé humaine et l'environnement comprennent l'élimination de la production autonome d'électricité au charbon, l'adoption de règlements locaux sur la qualité de l'air et l'établissement de normes rigoureuses pour la qualité de l'eau ambiante, la qualité de l'air, l'assainissement des sols et l'eau potable.
En vertu de l'Accord Canada-Ontario de 2014 sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, les Parties ont identifié des produits chimiques préoccupants qui proviennent de sources anthropiques (humaines) et qui sont potentiellement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. Les dix substances chimiques identifiées étaient : le mercure, les polychlorobiphényles (PCB), les polybromodiphényléthers (PBDE), l'hexachlorobromodododécane (HBCD), les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), l'acide perfluorooctanoïque (APFO), le perfluoroctane sulfonate (PFOS), les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC), le plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La présente annexe contient des engagements de coopération en matière de recherche, de suivi, de surveillance et de gestion des risques pour ces substances chimiques préoccupantes. En outre, la présente annexe met l'accent sur les mesures visant à réduire les risques et les incidences d'autres polluants susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine et écologique, notamment les déchets plastiques et les microplastiques.
Il faut faire preuve de vigilance au moyen de programmes de surveillance et de contrôle pour détecter si les produits chimiques hérités augmentent de façon inattendue ou si de nouveaux produits chimiques apparaissent dans divers milieux (eau, poisson, sédiments) dans les Grands Lacs. Pour y parvenir efficacement, nous devons élaborer et mettre en œuvre de nouveaux outils d'analyse et de suivi.
Les engagements énoncés dans l'annexe sur les polluants nocifs ont des liens avec plusieurs autres annexes, notamment les eaux usées et les eaux de ruissellement, les secteurs préoccupants, l'aménagement panlacustre, les éléments nutritifs, les eaux souterraines, l'habitat et les espèces, de la sensibilisation aux mesures, les Premières nations et les Grands Lacs et les Métis et les Grands Lacs.
Résultat 1 – Rendre compte des activités de recherche et de surveillance et des connaissances acquises dans le cadre des accords Canada-Ontario relatives aux produits chimiques préoccupants et à d'autres polluants nocifs, afin de contribuer à l’élaboration de mesures.
Le Canada et l’Ontario :
- Prépareront, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, un rapport résumant les connaissances acquises dans le cadre de l'Accord Canada-Ontario de 2014 sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin d'éclairer les futurs programmes et décisions concernant la présente annexe;
- Prépareront, au cours de la dernière année de la présente entente, un rapport qui résume les connaissances acquises dans le cadre du présent Accord, afin d'éclairer les priorités pour le prochain Accord.
Résultat 2 – Les rejets de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs sont réduits ou éliminés dans le bassin des Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Feront la promotion et appuieront, dans le cadre de leurs pouvoirs, programmes et stratégies respectifs et en consultation avec les secteurs pertinents au besoin : la gestion du cycle de vie; l'utilisation de substances chimiques plus sûres; la mise en place de meilleures pratiques et technologies de gestion pour réduire ou éliminer l'utilisation et les rejets de produits chimiques préoccupants; les produits contenant des produits chimiques préoccupants;
- Examineront et évalueront régulièrement les progrès et l'efficacité des activités de prévention et de réduction de la pollution pour les produits chimiques préoccupants, en adaptant les approches, au besoin;
- Élaboreront et mettront en œuvre mutuellement le volet canadien des stratégies binationales relatives aux produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, s'il y a lieu, comme convenu dans l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
- Examineront et évalueront en coopération les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies binationales relatives aux produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, et adapteront les méthodes de gestion et autres mesures en fonction des besoins.
Le Canada :
- Collaborera avec les gouvernements continentaux et d'autres gouvernements internationaux pour réduire ou éliminer les dépôts de produits chimiques transfrontières préoccupants;
- Prendra des mesures de promotion de la conformité et d'application, le cas échéant, dans le cas des mesures de prévention ou de réduction de la pollution mises en œuvre en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou d'autres lois fédérales sur les produits chimiques préoccupants;
- Fournira un appui financier aux projets qui accroissent la participation à l'application d'autres mesures que les mesures de conformité en élaborant, en mettant en œuvre, en évaluant et en encourageant l'utilisation d'approches novatrices et de meilleures pratiques.
L’Ontario :
- Continuera de collaborer avec les municipalités et d'autres organismes pour accroître le détournement des matières contenant des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs du flux des déchets par la recherche, la surveillance et l'éducation;
- Collaborera avec les secteurs clés pour élaborer, appuyer et améliorer les programmes et les meilleures pratiques de gestion qui réduisent les rejets de produits chimiques préoccupants;
- Collaborera avec des petites et moyennes entreprises et d'autres entreprises qui rejettent des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs dans les réseaux d'égouts municipaux afin de réduire leurs apports à ces réseaux;
- Collaborera avec les milieux universitaires, l'industrie, les municipalités et les parties prenantes pour promouvoir la mise au point de technologies et d'activités vertes favorisant la chimie verte;
- Améliorera l'éducation et la sensibilisation concernant les produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs présents dans les produits de consommation;
- Entreprendra des stratégies de promotion de la conformité et mettre en œuvre des normes et des directives pour réduire davantage les substances contenant des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs;
- Poursuivra des initiatives et activités d'éducation et de sensibilisation visant à réduire les rejets de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs par la promotion de pratiques écologiquement rationnelles et de mesures de prévention de la pollution;
- Entreprendra des projets supplémentaires pour réduire les produits chimiques préoccupants et autres polluants nocifs provenant à la fois de sources à l'intérieur et à l'extérieur du bassin. Ces projets comprendront une prévention de la pollution, des ententes volontaires et des meilleures pratiques de gestion;
- Élaborera des normes fondées sur la technologie pour appuyer la réduction des émissions dans l'atmosphère de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs.
Résultat 3 – Entreprendre en collaboration des activités de recherche, de surveillance et de contrôle afin d'améliorer les connaissances scientifiques sur la présence de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs dans les Grands Lacs et leur impact potentiel sur la santé humaine et écologique.
Le Canada et l’Ontario :
- En vertu de leurs pouvoirs, programmes et stratégies respectifs, mèneront des activités de recherche, de contrôle et de surveillance coordonnées pour les produits chimiques préoccupants dans le bassin des Grands Lacs, qui pourraient comprendre :
- La détermination et l'évaluation des événements, des sources, des charges, du transport et des répercussions des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs afin de déterminer où une gestion supplémentaire pourrait être nécessaire;
- Analyse non ciblée des milieux environnementaux des Grands Lacs pour appuyer la détection et l'identification des contaminants inconnus, afin de donner rapidement l'alerte pour les produits chimiques qui pourraient devenir des produits chimiques préoccupants;
- Examen et classement des besoins en matière de recherche sur une base régulière, en tenant compte des progrès réalisés;
- Élaboration, amélioration et validation des outils, des méthodes et des techniques d'échantillonnage et d'analyse pour la mesure des produits chimiques préoccupants et d’autres polluants nocifs qui ont une incidence sur la santé humaine et écologique dans l'environnement ainsi que l'évaluation de leurs répercussions potentielles.
- Prendront des mesures pour faire progresser les connaissances sur la façon dont les produits chimiques préoccupants sont rejetés par les produits en fin de vie;
- Échangeront des données sur les polluants nocifs susceptibles d'avoir des incidences sur les Grands Lacs, y compris des données sectorielles, à moins qu'elles ne soient interdites par la loi pertinente ou applicable et conformément à celle-ci;
- Feront participer les collectivités des Premières nations, des Métis et d'autres collectivités intéressées, qui comptent sur le poisson des Grands Lacs comme source nutritionnelle importante pour leur alimentation, à la réduction de leur exposition aux polluants nocifs, afin de s'assurer que leurs habitudes de consommation particulières soient prises en compte, que les avis élaborés soient appropriés pour ces collectivités et communiqués adéquatement;
- Continueront de surveiller les concentrations de chlorure dans l'eau afin de mieux comprendre les conditions, les tendances et les répercussions sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.
Résultat 4 – Critères de qualité environnementale, qui comprennent des lignes directrices, des objectifs ou des normes pour les produits chimiques préoccupants et les polluants nocifs, au besoin, sont établis.
Le Canada et l’Ontario :
- Travailleront ensemble à l'élaboration de critères de qualité environnementale pour les produits chimiques préoccupants, au besoin;
- Achèveront les études d'essais de toxicité chronique des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) afin de créer un corpus scientifique suffisant pour élaborer des recommandations appropriées pour la qualité de l'environnement.
Le Canada :
- Tiendra à jour, examinera périodiquement et rendra publique une liste des critères fédéraux et canadiens actuels de qualité environnementale pour les produits chimiques préoccupants.
L’Ontario :
- Élaborera des lignes directrices sur les chlorures propres à chaque site pour les zones constituant l'habitat principal des espèces sensibles aux chlorures;
- Mettra au point des indicateurs environnementaux des résultats du traitement des eaux usées donnant une idée des effets à long terme sur la santé des écosystèmes.
Résultat 5 – Réduction de la pollution plastique dans le bassin des Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Appuieront les projets de captage et d'assainissement visant à prévenir et à éliminer la pollution plastique de nos cours d'eau et de nos terres;
- Appuieront l'élaboration d'un plan d'action, par l'entremise du Conseil canadien des ministres de l'environnement, pour la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne et un plan d’action sur l'élimination totale des déchets de plastique, afin de réduire les déchets plastiques et la pollution, y compris les microplastiques, qui peuvent se retrouver dans les rivières et lacs du bassin des Grands Lacs;
- Feront progresser les activités de recherche, de surveillance et de contrôle de la pollution plastique et microplastique dans le bassin des Grands Lacs, notamment :
- Partager l'information sur les effets, les sources, les possibilités, les mesures d'atténuation et les méthodes de réduction;
- Travailler à la normalisation des procédures de surveillance et d'analyse.
- Accroîtront la sensibilisation et l'éducation pour réduire les déchets plastiques et la pollution dans le bassin des Grands Lacs.
Le Canada :
- Participera aux initiatives binationales des Grands Lacs visant à réduire la pollution plastique, y compris les microplastiques, dans les Grands Lacs;
- Appuiera la mise en place de technologies et processus novateurs;
- Par son travail dans le cadre de la Charte sur les plastiques dans les océans et du plan d'action de la stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique :
- Faciliter la normalisation des programmes de responsabilité élargie des producteurs applicables au plastique;
- Élaborer des exigences et des normes nationales de rendement, notamment en ce qui concerne le contenu recyclé, la compostabilité, la réparabilité et le reconditionnement/la remise à neuf;
- Élaborer des accords et des outils pour appuyer la gestion appropriée des plastiques;
- Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices et des outils pour assurer des pratiques d'approvisionnement responsable qui intègrent les principes des pratiques exemplaires en matière de gestion des plastiques.
- Promouvra les investissements admissibles dans les installations de recyclage dans le cadre de l'infrastructure applicable et d'autres programmes de financement.
L’Ontario :
- Prendra des mesures pour réduire la quantité de déchets produits dans la province, y compris les déchets plastiques, et détournera davantage de déchets des décharges, notamment :
- Passer de l'actuel Programme des boîtes bleues à un modèle de responsabilité des producteurs;
- Travailler pour augmenter la quantité de déchets détournés par le secteur industriel, commercial et institutionnel;
- Explorer des possibilités de technologies novatrices, comme le traitement thermique et le recyclage chimique, permettant de récupérer des ressources précieuses, comme les résines plastiques, les combustibles synthétiques et l'électricité, à partir des déchets.
- Collaborera avec des partenaires de l'industrie pour encourager des pratiques exemplaires sur les sites industriels (hygiène industrielle, filtration des rejets d'eaux usées), en mettant l'accent sur les sites de l'ouest du lac Ontario où les concentrations microplastiques les plus élevées ont été observées;
- Veillera à ce que les auteurs récidivistes de pollution plastique soient sévèrement sanctionnés en procédant à un examen des cadres politiques et législatifs existants et en apportant toutes les améliorations nécessaires pour faire face aux dépôts et aux rejets de plastique et de microplastiques dans l'eau;
- Examinera la pollution plastique dans les politiques relatives aux eaux usées et aux eaux de ruissellement.
Résultat 6 – Quand des preuves scientifiques indiquent un besoin, de nouveaux produits chimiques préoccupants sont identifiés et désignés et les produits chimiques préoccupants existants sont examinés périodiquement en vue de leur élimination.
Le Canada et l’Ontario :
- Fourniront des motifs à l'appui de leur désignation mutuelle, conformément aux principes du présent Accord, pour chacun de leurs produits chimiques préoccupants candidats respectifs y compris, sans s'y limiter :
- Les données de surveillance et de suivi ou d'autres données de substitution (p. ex. Les secteurs industriels clés et d'autres sources d'exposition) qui indiquent la présence ou un potentiel raisonnable de la présence de la substance chimique dans la région des Grands Lacs et également des preuves indiquant que la substance entraîne des répercussions néfastes prouvées ou probables sur les Grands Lacs;
- Un aperçu des mesures passées et actuelles de prévention et de contrôle de la pollution;
- Une détermination des lacunes en matière de renseignements ou de technologie.
- Évalueront et approuveront la désignation des substances chimiques d'intérêt prioritaire dans le bassin des Grands Lacs, à l'aide des critères binationaux d'évaluation des substances chimiques sources de préoccupations mutuelles établis en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
- Détermineront les produits chimiques préoccupants dont la désignation est proposée au sous-comité Canada-États-Unis sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles du Comité exécutif binational des Grands Lacs, en tant que produits chimiques préoccupants proposés sources de préoccupations mutuelles binationales;
- Examineront la possibilité de désigner ces produits chimiques préoccupants en vertu du présent Accord, pour les substances chimiques proposées par les États-Unis aux fins d'examen comme produits chimiques sources de préoccupations mutuelles binationales;
- Examineront périodiquement les produits chimiques préoccupants et les nouveaux produits chimiques potentiels à l'échelle fédérale ou provinciale, afin de déterminer s'ils doivent demeurer ou être inclus, respectivement, comme étant des priorités pour le bassin des Grands Lacs;
- Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques et des programmes provinciaux, continueront d'évaluer, de cerner et de gérer les risques associés aux produits chimiques qui peuvent avoir une incidence négative sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé des écosystèmes.
Le Canada :
- Proposera la candidature de produits chimiques préoccupants au Sous-comité Canada- États-Unis sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles du Comité exécutif Canada-États-Unis des Grands Lacs, pour examen en tant que produits chimiques binationaux sources de préoccupations mutuelles.
annexe 3 : eaux usées et eaux de ruissellement
La présente annexe vise à améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement et à réduire la pollution dans les Grands Lacs.
Les eaux usées et les eaux de ruissellement transportent dans les Grands Lacs des éléments nutritifs, ainsi que des polluants nocifs comme le sel, des agents pathogènes et des contaminants d'intérêt émergent. La gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement est donc essentielle pour garder les Grands Lacs propres, pour protéger la qualité de l'eau, les plages et la santé publique. Le contrôle des sources de pollution en amont, ainsi que de ces voies de pollution, est plus efficace et moins coûteux que le nettoyage de la pollution une fois qu'elle atteint les lacs.
Conformément au principe du traitement adéquat des eaux usées en vertu de l'Accord Canada- États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, la présente annexe porte sur la gestion des éléments nutritifs, des polluants nocifs et des agents pathogènes présents dans les eaux usées et les eaux de ruissellement, et contribue à la réalisation des objectifs des annexes du présent accord relatives aux éléments nutritifs et aux polluants dangereux.
L'amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement exige des investissements importants, une planification à long terme et des normes et des politiques claires. Plusieurs partenaires jouent un rôle dans la bonne gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, notamment les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.
Le gouvernement du Canada accorde des fonds pour l'infrastructure verte dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tel qu'établi dans une entente bilatérale intégrée avec l'Ontario. Le financement fédéral et provincial accordé dans le cadre de ce programme peut appuyer des projets d'infrastructure publique qui se traduisent par une capacité accrue de traitement et de gestion de l'eau et des eaux usées. Les projets peuvent comprendre l'amélioration de l'infrastructure naturelle ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de l'eau et des eaux usées. De plus, la province fournit un financement fondé sur une formule dans le cadre du Fonds ontarien d'infrastructure communautaire pour aider les petites collectivités rurales et du Nord à construire et à réparer l'infrastructure de base, y compris les systèmes de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement.
La province de l'Ontario réglemente les eaux usées et les eaux de ruissellement municipales au moyen d'approbations de conformité environnementale afin de protéger l'environnement naturel et la santé humaine. L'une des grandes priorités de l'Ontario est de collaborer avec les municipalités pour améliorer la surveillance des dérivations et des débordements d'eaux usées et les rapports publics à ce sujet. Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à revoir et à mettre à jour ses politiques sur les eaux usées et à élaborer une nouvelle politique de gestion des eaux pluviales afin d'améliorer la protection de l'environnement et de réduire les agents pathogènes et les contaminants qui peuvent avoir un impact sur les Grands Lacs.
Cette annexe vise à améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement afin d'améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, notamment par la promotion d'investissements admissibles dans le cadre de programmes d'infrastructure et d'autres programmes de financement, l'application des normes de qualité des effluents, la recherche et la surveillance afin de mieux comprendre les concentrations et tendances des contaminants et d'améliorer les mesures de gestion.
Résultats 1 – Les charges excessives d'éléments nutritifs provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées dans les collectivités urbaines et rurales sont réduites.
Le Canada et l’Ontario :
- Détermineront et feront la promotion des mesures prioritaires pour aider les municipalités à respecter les engagements pris dans l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
- Feront la promotion de la planification de l'infrastructure et les investissements admissibles à l'appui de la réduction de l'excès d'éléments nutritifs provenant de sources ponctuelles, comme les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées municipales, y compris les débordements et les dérivations, en priorité dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;
- Feront la promotion des investissements admissibles, y compris les investissements dans l'infrastructure verte, qui favorisent la réduction de l'excès d'éléments nutritifs provenant de sources diffuses comme les eaux de ruissellement urbaines et rurales (y compris les celles provenant de paysages agricoles), en tant que considérations prioritaires dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;
- Examineront ou appuieront la démonstration de pratiques et de technologies novatrices qui permettent d'améliorer la protection de l'environnement, tout en réduisant la dépendance à l'égard du financement des infrastructures classiques. Il peut s'agir, par exemple, de la planification stratégique à long terme de l'infrastructure, de l'optimisation des usines de traitement des eaux usées, de la réduction du volume des eaux de ruissellement pour que les égouts pluviaux ou unitaires en recueillent moins, de la récupération et de la réutilisation du phosphore et des eaux, du recouvrement intégral des coûts des services municipaux d'assainissement des eaux usées et de ruissellement, avec des incitatifs.
L'Ontario :
- Mettra à jour les politiques relatives aux eaux usées, y compris des politiques propres aux besoins de traitement, aux débordements d'eaux usées et aux dérivations, et élaborera une nouvelle politique de gestion des eaux de ruissellement, afin de renforcer la protection de l'environnement et de réduire les charges en éléments nutritifs;
- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera de surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à obtenir des avantages connexes de la réduction des éléments nutritifs;
- Collaborera avec les municipalités et d'autres parties prenantes pour surveiller le rendement et l'efficacité de l'infrastructure des eaux de ruissellement et de l'infrastructure verte et communiquera publiquement les résultats, y compris les avantages connexes de la réduction des éléments nutritifs;
- Collaborera, dans la mesure du possible, avec les partenaires municipaux pour réduire les charges en améliorant les systèmes de gestion des eaux de ruissellement (y compris la remise en état des installations et l'intégration d'une infrastructure verte et de technologies de traitement novatrices);
- Collaborera avec les promoteurs, les municipalités, les offices de protection de la nature et d'autres intervenants pour promouvoir et soutenir l'utilisation d'infrastructures vertes et de systèmes de développement à faible impact pour la gestion des eaux de ruissellement, notamment en clarifiant et en améliorant les politiques;
- Appuiera des études permettant de mieux comprendre la corrélation entre la réduction des charges de phosphore et la mise en œuvre d'infrastructures vertes et le développement à faible impact;
- Mènera un examen de l'approche de la province en matière de gestion des eaux de ruissellement et du drainage agricole en milieu rural à l'aide d'une approche intégrée par bassin versant;
- Étudiera davantage les fosses septiques comme source de contamination des eaux des Grands Lacs par les eaux souterraines, les eaux de surface et par des voies préférentielles.
Résultat 2 – Les charges de contaminants provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées dans les collectivités urbaines et rurales sont réduites.
Le Canada et l’Ontario :
- Définiront et feront la promotion, conformément aux plans d'action et d'aménagement panlacustres, des mesures prioritaires pour les contaminants (nouveaux et classiques) et les agents pathogènes provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, des eaux de ruissellement urbaines et rurales, des installations septiques domestiques rurales et d'autres sources rurales;
- Feront la promotion de la planification de l'infrastructure et des investissements admissibles à l'appui de la réduction des charges de contaminants et d'agents pathogènes en tant que considérations prioritaires dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;
- Entreprendront des projets d'échantillonnage des effluents des stations d'épuration des eaux usées du bassin des Grands Lacs qui pourraient servir à mieux comprendre les concentrations de contaminants entrant dans les Grands Lacs; fourniront des données de référence pour évaluer les mesures de contrôle futures; et détermineront les tendances temporelles;
- Étudieront les possibilités de recherche, de suivi et de surveillance liées à la gestion des technologies de traitement à la source et en amont, sous leur autorité respective, pour s'attaquer aux polluants nocifs dans les effluents et les résidus d'eaux usées.
Le Canada :
- Continuera d'appliquer les normes de qualité des effluents et les exigences en matière de surveillance et de signalement des systèmes de traitement des eaux usées en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (2012);
- Publiera régulièrement des rapports publics sur le nombre de jours où les plages sont ouvertes et sûres pour la baignade sur les plages surveillées des Grands Lacs, au moyen de rapports sur l'état des Grands Lacs;
- Collaborera avec les organisations routières, les municipalités, les offices de protection de la nature et d'autres partenaires pour promouvoir les meilleures pratiques de gestion pour les organisations routières en rapport avec le Code de pratique pour gestion environnementale des sels de voirie du Canada;
- Examinera les progrès obtenus par la mise en place du Code de pratique pour gestion environnementale des sels de voirie du gouvernement du Canada.
L’Ontario :
- Mettra à jour les politiques ontariennes sur les eaux usées et élaborera une nouvelle politique de gestion des eaux de ruissellement, y compris des politiques propres aux exigences de traitement, aux débordements d'eaux usées et aux dérivations, afin d'améliorer la protection environnementale et de réduire les agents pathogènes et les contaminants dans les effluents;
- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera à surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à tirer profit des avantages connexes de la réduction des agents pathogènes et des contaminants;
- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera à surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à tirer profit des avantages connexes de la réduction des agents pathogènes et des contaminants;
- Élaborera des outils de communication pour mieux informer le public au sujet des fosses septiques, de l’importance de leur entretien, et de la contamination éventuelle des puits d'eau potable autres que municipaux, afin de protéger la santé publique et de réduire les répercussions possibles sur la qualité de l'eau des Grands Lacs;
- Améliorera la compréhension des causes d'E. coli, d’algues ou d'autres substances qui peuvent avoir un impact sur l’utilisation et la fréquentation des plages;
- Fera la promotion de l’utilisation d’outils améliorés de gestion des plages;
- S'appuiera sur les activités existantes de protection des sources d'eau potable pour faire en sorte que les incidences environnementales dans l'utilisation des sels de voirie sur l'écosystème des Grands Lacs soient réduites au minimum;
- Collaborera avec les municipalités, les offices de protection de la nature, le secteur privé et d'autres partenaires pour promouvoir les meilleures pratiques de gestion, la certification et les solutions de rechange en matière d'épandage des sels de voirie, y compris sur les chemins privés, les trottoirs et les terrains de stationnement, tant publics que privés;
- Évaluera les voies d'entrée du sel de voirie dans les eaux souterraines, les effets de l'utilisation du sel de voirie sur les eaux souterraines et les eaux souterraines en tant que source de contamination des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques par le sel;
- Étudiera les technologies ou les procédés permettant d'empêcher le chlorure de sel de voirie de pénétrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
annexe 4 : rejets provenant des bateaux
La présente annexe a pour objet de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'annexe 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs - Rejets des bateaux, par laquelle le Canada et les États-Unis se sont engagés à prévenir et à contrôler les rejets des bateaux qui nuisent à la qualité des eaux des Grands Lacs, en adoptant et en appliquant des règlements, programmes et autres mesures qui favorisent une application coordonnée et coopérative, le cas échéant.
En vertu de la Constitution du Canada, la navigation et l'expédition sont sous la compétence exclusive du Parlement fédéral. Les lois, les règlements, les programmes de réglementation existants, les protocoles d’inspections et les régimes d'application de la loi sont conçus pour lutter contre les menaces des rejets provenant des bateaux qui pèsent sur les Grands Lacs
Les rejets de substances polluantes dangereuses par les bateaux ont été traités dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs depuis qu'il a initialement été signé en 1972. Le pétrole était à l'origine le rejet le plus préoccupant. L'introduction de moules zébrées en 1988 a mis l'accent sur le potentiel d'introduire des espèces aquatiques envahissantes dans les Grands Lacs par l’entremise du rejet d’eau de ballast par des bateaux.
L'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs comprend l'engagement du gouvernement du Canada à travailler en collaboration et en consultation avec les gouvernements des États et des provinces, les gouvernements tribaux, les Premières Nations, les Métis, les administrations municipales, les organismes de gestion des bassins versants, les autres organismes publics locaux et le public pour adopter des programmes et des mesures, en tenant compte des directives et normes élaborées par l'Organisation maritime internationale, pour protéger les eaux des Grands Lacs en : s’attaquant aux rejets de quantités nocives d'hydrocarbures ou de polluants dangereux, d'ordures, d'eaux usées et d'eaux usées; prenant des mesures pour prévenir les rejets d'EAE et d'agents pathogènes résultant de l'encrassement biologique et des eaux de ballast; empêchant les dommages causés par les systèmes antisalissure.
Le rapport d’étape des parties sur l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, présenté à la Commission mixte internationale par le Canada et les États-Unis en 2019, indique que les rejets potentiels d'hydrocarbures et de substances dangereuses, de déchets, d'eaux usées, d'eau de ballast et d'eaux usées des bateaux sont bien réglementés. Les régimes réglementaires nationaux canadiens et américains et les conventions internationales applicables ont réduit le risque de rejets préoccupants des bateaux. Le Canada et les États-Unis sont déterminés à continuer de prévenir et de réduire les menaces que les rejets de tous les bateaux représentent pour les eaux des Grands Lacs.
En vertu de l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs (2021), la présente annexe comprend un engagement à limiter et à contrôler les rejets des bateaux qui nuisent à la qualité des Grands Lacs en mettant en œuvre des mesures prioritaires en vertu de l'annexe 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs.
Résultat 1 – Poursuite de la mise en œuvre par le Canada des engagements pris dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs Annexe 5 - Rejets des bateaux.
Le Canada :
- Mettra en œuvre, pour sa part, les engagements et les mesures prioritaires de l'annexe 5 (Rejets des bateaux) de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs au moyen de politiques, de lois ou de règlements, de recherches, de conformité et d'application.
priorité – améliorer les zones littorales
Cette priorité met l’accent sur la restauration, la protection et la conservation des zones littorales des Grands Lacs, dont les terres humides et les plages. L'annexe sur les secteurs préoccupants comprend des initiatives pour appuyer la restauration continue de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème des zones désignées de la région des Grands Lacs. L'annexe sur l'aménagement panlacustre comprend des engagements visant à actualiser et à mettre en œuvre des plans d'aménagement panlacustre pour chacun des quatre Grands Lacs du Canada et leurs réseaux hydrographiques principaux, ainsi qu'à élaborer et à continuer à mettre en œuvre un cadre intégré pour les zones littorales.
annexe 5 : secteurs préoccupants
L'objectif de la présente annexe est de restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans les secteurs préoccupants.
Les secteurs préoccupants (SP) sont des zones géographiques situées dans le bassin des Grands Lacs, qui ont été identifiées au milieu des années 1980 parce que la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème ont été gravement dégradées par les activités humaines, au point que les utilisations bénéfiques en étaient altérées. La restauration de ces zones est avantageuse, et pas seulement pour la collectivité locale; elle contribue à améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans toute la région des Grands Lacs. Quarante-trois emplacements ont été officiellement reconnus comme des secteurs préoccupants par le Canada et les États-Unis en vertu du Protocole de 1987 modifiant l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs : douze au Canada, vingt-six aux États-Unis, ainsi que cinq secteurs préoccupants binationaux partagés par les deux pays.
La dégradation de l'environnement dans les secteurs préoccupants est principalement un héritage du passé causé par les activités industrielles, l'agriculture, les eaux de ruissellement urbaines et rurales, les effluents d'eaux usées municipales, la planification de l'utilisation des terres et les pratiques sur des terres urbaines et rurales. Ces pratiques antérieures ont entraîné une dégradation de la qualité de l'eau, contaminé les sédiments des rivières et des lacs, et ont gravement touché les populations et les habitats des poissons et des espèces sauvages.
En travaillant avec des membres de la collectivité et les gouvernements locaux, le Canada et l'Ontario mettent en œuvre des plans d'assainissement pour restaurer les utilisations bénéfiques dans les secteurs préoccupants. Des progrès considérables ont été réalisés, et en 2010, trois de ces secteurs au Canada ont été entièrement restaurés et officiellement radiés de la liste (ils ne sont plus considérés comme un secteur préoccupant) : le port de Collingwood en 1994, le bras Severn en 2003 et le port de Wheatley en 2010. Toutes les mesures correctives recommandées ont été effectuées pour deux secteurs préoccupants canadiens supplémentaires, qui ont été reconnus comme étant en voie de rétablissement : le port de Spanish en 1999 et la baie Jackfish en 2011. La surveillance environnementale continue de confirmer la restauration de la qualité de l'eau et des processus des écosystèmes.
Dans les autres secteurs préoccupants canadiens et binationaux de l’Accord Canada-Ontario, des efforts continus sont nécessaires pour compléter la mise en œuvre des plans d'assainissement (PA) pour restaurer la qualité des écosystèmes. Dans le cadre de cet Accord, toutes les mesures requises pour respecter les critères de retrait de la liste et rétablir l’utilisation bénéfique seront prises dans les SP de la baie Nipigon, du havre Peninsula, de la rivière Niagara, du port de Port Hope, de la baie de Quinte et du fleuve Saint-Laurent. Les parties continueront de faire des progrès à Thunder Bay, à la rivière Sainte Marie, à la rivière Sainte-Claire, à la rivière Detroit, au port de Hamilton, ainsi qu’aux SP de Toronto et de la région. Les parties continueront également de surveiller la restauration de l’utilisation bénéfique dans les SP de la baie de Jackfish et du port de Spanish qui sont en voie de rétablissement, y compris afin d’appuyer la confirmation du retrait de la liste du port de Spanish.
Les efforts de collaboration décrits dans la présente annexe appuient l'atteinte des résultats des autres annexes du présent Accord. Par exemple, les travaux de restauration dans le SP appuient les efforts de restauration, de protection et de conservation de la résilience des espèces indigènes des Grands Lacs et de leurs habitats, qui font l'objet de l'annexe Habitat et espèces.
Cela contribuera à l'objectif à long terme de retirer les SP restants de la liste et de veiller à ce que les améliorations environnementales obtenues grâce au processus des SP soient maintenues.

Cette carte illustre les secteurs préoccupants canadiens et américains des Grands Lacs, comme indiqué dans la présente annexe. Secteur préoccupant canadien: Baie Thunder, Baie Nipigon, Havre Peninsula, Havre de Hamilton, Communauté urbaine de Toronto, Havre de Port Hope, Baie de Quinte. Secteur préoccupant canadien retiré de la liste: bras Severn, Havre de Collingwood, Havre de Wheatley. Secteur canadien en voie de rétablissement: Havre de Spanish, baie Jackfish. Secteur préoccupant binational : Rivière St. Mary's, Rivière Sainte-Claire, Rivière Détroit, Rivière Niagara, Fleuve Saint-Laurent. Secteur préoccupant américain: Rivière/Baie St. Louis, Lac Torch, Lac Deer - Rivière Carp Creek/River, Rivière Manistique, Rivière Menominee, Rivière Fox/Baie Green Sud, Rivière Sheboygan, Estuaire Milwaukee, Havre Waukegan, Rivière Grand Calumet, Rivière Kalamazoo, Lac Muskegon, Lac White, Rivière/Baie Saginaw, Rivière Clinton, Rivière Rouge, Rivière Raisin, Rivière Maumee, Rivière Black, Rivière Cuyshoga, Rivière Ashtabula, Rivière Buffalo, Ruisseau Eighteen Mile, Rentrant de Rochester. Secteur préoccupant américain retiré de la liste: Rivière Oswego, Baie Presque Isle. Secteur américain en voie de rétablissement: Aucun.
Carte des secteurs préoccupants des Grands Lacs
Résultat 1 – Faire progresser l'assainissement des SP en améliorant la coordination et la coopération.
Le Canada et l’Ontario :
- Se réuniront chaque année pour discuter des priorités en matière d'assainissement des SP et des stratégies visant à maximiser la coopération et la coordination.
Résultat 2 – Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les quatre altérations de l’utilisation bénéfique dans le SP de Thunder Bay : dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, dégradation du benthos, fermeture des plages, perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages et déterminer l'état de trois autres utilisations bénéfiques qui nécessitent une évaluation plus poussée : Restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de quatre utilisations bénéfiques altérées restantes et d’une nécessitant une évaluation plus approfondie :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions sur la consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à une nouvelle désignation de la dégradation des utilisations bénéfiques pour la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation du benthos, la fermeture des plages, la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages et une désignation des utilisations bénéfiques nécessitant une évaluation supplémentaire : Restrictions sur la consommation de poissons et d'espèces sauvages.
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des utilisations bénéfiques :
- Fournir un soutien financier et technique aux projets prioritaires de restauration de l'habitat afin d'améliorer l'habitat riverain et riverain et d'atteindre les critères de retrait de la liste pour la perte de l'habitat du poisson et de la faune.
- Produiront une option privilégiée pour la gestion des sédiments contaminés dans le SP de Thunder Bay :
- Faire participer les parties prenantes, les Premières Nations et les Métis dans la création d’un consensus sur une option privilégiée pour gérer les sédiments contaminés;
- Élaborer une conception technique détaillée du projet et une estimation des coûts pour appuyer la prise de décisions liées à la mise en œuvre du projet.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des utilisations bénéfiques diminuées.
Résultat 3 – Confirmer le rétablissement des utilisations bénéfiques et retirer de la liste les SP de la baie Nipigon.
Le Canada et l’Ontario :
- Appuieront la modernisation de l'infrastructure de l'installation de traitement des eaux usées du canton de Red Rock, qui passera du traitement primaire au traitement secondaire;
- Finaliseront le rapport d'achèvement du plan d'assainissement de la baie Nipigon;
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis au retrait de l'inscription de ce SP.
Résultat 4 – Poursuivre la mise en œuvre de la surveillance environnementale, des mesures de gestion et des rapports, et faire des progrès pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les trois utilisations bénéfiques restantes dans le SP de la baie Jackfish en rétablissement : Dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, dégradation du benthos et perte d'habitat de poissons et d'animaux sauvages; et déterminer l'état de deux autres utilisations bénéfiques qui nécessitent une évaluation plus poussée : Restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages et la dégradation des produits esthétiques.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de trois utilisations bénéfiques altérées restantes et de deux autres nécessitant une évaluation plus approfondie :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions sur la consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Déterminer l'état des populations de poissons afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des critères de retrait de la liste;
- Effectuer des évaluations de l'état, s'il y a lieu, préparer des rapports d'évaluation de l'état et procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages et la perte d'habitat du poisson et d'animaux sauvages; et un état de deux utilisations bénéfiques nécessitant une évaluation plus approfondie: Restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages et dégradation des produits esthétique.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Surveilleront l'efficacité du rétablissement naturel de la baie de Moberly, dans la baie Jackfish, afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des critères de retrait de la liste;
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à la prise de décisions concernant l'altération de l’utilisation bénéfique.
Résultat 5 –Compléter les mesures restantes requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les deux utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP du havre Peninsula : Restrictions sur la consommation de poisson et de la faune et la dégradation du benthos, et déterminer l'état de deux autres utilisations bénéfiques qui nécessitent une évaluation plus poussée : Dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages et perte d'habitats de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de deux utilisations bénéfiques altérées restantes et de deux autres nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions sur la consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Déterminer l'état des populations de poissons et de l'habitat du poisson et de la faune afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poisson et de la faune et la dégradation du benthos, et à une désignation des altérations de l'utilisation bénéfique nécessitant une évaluation plus approfondie : Dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages et perte d'habitat de poissons et d'animaux sauvages.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Surveilleront l'efficacité de l'assainissement des sédiments contaminés par la couche mince :
- Examiner les résultats de la surveillance postérieure à l'assainissement afin de déterminer l'efficacité de l'option de gestion.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à la prise de décisions concernant l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique, la désignation du SP comme SP en voie de rétablissement ou le retrait de la liste de ce SP.
L'Ontario :
- Procédera à une surveillance long terme de l’efficacité de la couche mince.
Résultat 6 – Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les six utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de la rivière Sainte-Marie : restrictions sur la consommation de poisson et de la faune, dégradation des populations de poissons et des animaux sauvages, tumeurs ou autres malformations du poisson, dégradation du benthos, restrictions des activités de dragage et perte de l’habitat de poissons et d’animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de six autres utilisations bénéfiques altérées :
- i.Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions sur la consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Déterminer l'état des populations de poissons afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de satisfaire les critères de retrait de la liste;
- Surveiller les foies de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à la nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons et d'espèces sauvages, la dégradation des populations de poissons et d'espèces sauvages, les tumeurs ou autres malformations des poissons, la dégradation du benthos, les restrictions des activités de dragage, la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages.
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des utilisations bénéfiques :
- Appuyer la restauration de l'habitat afin d'atteindre les critères de retrait de la liste pour la perte de l’habitat de poissons et d’animaux sauvages.
- Complèteront une stratégie de gestion des sédiments et fourniront des conseils pour gérer les sédiments contaminés dans le SP de la rivière Sainte Marie :
- Faire participer les parties prenantes concernées, les Premières Nations et les Métis, à l'établissement d'un consensus en vue d'élaborer un plan de gestion des sédiments contaminés à l'est du parc marin Bellevue;
- Poursuivre la collaboration avec l'industrie locale en ce qui concerne le dragage des sédiments dans la cale de mise à l'eau d'Algoma.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique.
Le Canada :
- Surveillera et gérera la qualité des sédiments dans le plan d'eau fédéral de la rivière Sainte-Marie, selon le cas;
- Collaborera avec la Première Nation de Batchewana pour faire progresser la restauration de l'habitat à Whitefish Island.
Résultat 7 –Compléter les mesures restantes requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les trois utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP du port de Spanish en voie de rétablissement : Restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation du benthos et les activités de dragage.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de trois autres utilisations bénéfiques altérées :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à la nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour des restrictions de la consommation de poissons et d’animaux sauvages et la dégradation du benthos.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Surveilleront l'efficacité de la récupération naturelle des sédiments contaminés dans le chenal Whalesback afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour la dégradation de Benthos.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à la prise de décisions concernant l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique et le retrait de la liste de ce SP.
Résultat 8 –Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait et rétablir quatre utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de la rivière Sainte-Claire : restrictions sur la consommation de poissons et d’animaux sauvages, dégradation du benthos, restrictions sur la consommation d'eau potable ou problèmes de goût et d'odeur et perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages; et déterminer l'état de deux autres utilisations bénéfiques nécessitant une évaluation plus approfondie : Dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages et tumeurs ou autres malformations des poissons.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de quatre utilisations bénéfiques altérées restantes et de deux autres nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer la surveillance des habitats de poissons et d’animaux sauvages (quantité et qualité) pour évaluer les progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste;
- Déterminer l’état des populations de poissons et d’animaux sauvages pour évaluer les progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste;
- Surveiller la qualité de l'eau en amont et en aval le long de la rivière Sainte- Claire afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poisson et de faune, les restrictions sur la consommation d'eau potable ou les problèmes de goût et d'odeur, la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages, et une désignation des utilisations bénéfiques nécessitant une évaluation approfondie : Dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages et des tumeurs ou autres malformations des poissons.
Le Canada :
- Effectuera une analyse des foies de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l'utilisation bénéfique pour la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages;
- Produiront des estimations techniques détaillées et des estimations de coûts pour l'option privilégiée d'assainissement des sédiments dans les trois zones prioritaires de la rivière Sainte-Claire pour faire avancer les progrès vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour la dégradation du benthos;
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique;
- Communiqueront, si nécessaire, avec les agences fédérales et étatiques des États- Unis sur les questions qui font progresser la restauration et le retrait de la liste de cette zone binationale préoccupante.
Le Canada :
- Collaborera avec la Première Nation de Walpole Island pour restaurer l'habitat des terres humides.
L’Ontario :
- Suivra les déversements afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour les restrictions de la consommation d'eau potable ou les problèmes de goût et d'odeur.
Résultat 9 –Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir six utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de la rivière Détroit : restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, malformations ou problèmes reproductifs des oiseaux ou des animaux, tumeurs ou autres malformations des poissons, dégradation du benthos et perte du milieu marin et sauvage, et déterminer la situation d'une utilisation avantageuse supplémentaire qui doit faire l'objet d'autres évaluations : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de quatre utilisations bénéfiques altérées restantes et d’une autre nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Déterminer l'état des populations de poissons afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de satisfaire aux critères de retrait de la liste;
- Déterminer l'état des habitats de poissons et d’animaux sauvages (quantité et qualité) dans les zones prioritaires afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Finaliser les modèles de poissons pour compléter le plan à long terme des habitats de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer des évaluations de l'état, s'il y a lieu, préparer des rapports d'évaluation de l'état et procéder à la nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons et de faune, la dégradation des populations de poissons et d’animaux sauvages, les malformations ou problèmes reproductifs des oiseaux ou des animaux, les tumeurs ou autres malformations des poissons, la dégradation du benthos, la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages, et un état de désignation de l'altération de l'usage bénéfique nécessitant une évaluation plus poussée : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
Le Canada :
- Mènera des études de surveillance sur les populations d’animaux sauvages pour évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuera une analyse des foies de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Mènera une surveillance pour déterminer l’état de Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l'utilisation bénéfique :
- Fournir un appui technique et financier aux mesures prioritaires pour faire progresser les progrès vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages et la dégradation des populations de poissons et d’animaux sauvages.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique;
- Communiqueront, si nécessaire, avec les agences fédérales et étatiques des États-Unis sur les questions qui font progresser la restauration et le retrait de la liste de cette zone binationale préoccupante.
Résultat 10 – Compléter les mesures restantes requises pour atteindre les critères de retrait et rétablir les cinq utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de la rivière Niagara : restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages; dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages; dégradation du benthos, fermeture des plages et perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de cinq autres altérations de l'utilisation bénéfique :
- Déterminer l'état des populations de poissons et les habitats de poissons et d’animaux sauvages afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Continuer de surveiller la qualité de l'eau, la qualité des sédiments en suspension et le biote en amont et en aval du SP de la rivière Niagara afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à la nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages; la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages; la dégradation du benthos, la fermeture des plages et la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l’utilisation bénéfique :
- Fournir un soutien technique et financier pour la conception de mesures correctives visant à réduire les niveaux élevés de bactéries à la plage Queen's Royal;
- Fournir un soutien technique et financier à un projet de terres humides côtières et d'habitat riverain afin d'améliorer l'habitat du poisson et d'atteindre les critères de retrait de la liste pour la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages et la dégradation des populations de poissons et d’animaux sauvages.
- Surveilleront la récupération naturelle des sédiments contaminés dans l’est du ruisseau Lyon :
- Surveiller l'efficacité de la récupération naturelle des sédiments contaminés dans l'est du ruisseau Lyon afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour la dégradation du benthos;
- Évaluer, le cas échéant, le besoin de mesures supplémentaires pour atteindre les critères de retrait de la liste;
- Fournir des conseils techniques aux organismes locaux sur l'application du protocole de contrôle administratif à l'est du ruisseau Lyon pour assurer la bonne gestion des sédiments contaminés.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique, en désignant le SP comme SP en voie de rétablissement ou en retirant ce SP de la liste des SP.
Résultat 11 – Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir huit utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP du port de Hamilton : restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, dégradation de l'esthétique, dégradation du benthos, restrictions sur le dragage, eutrophisation ou algues indésirables, fermeture de plages et perte de l'habitat du poisson et de l'espèce; et déterminer la situation des trois autres utilisations bénéfiques exigeant une évaluation approfondie : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton, tumeurs ou autres malformations des poissons et malformations des oiseaux ou des animaux ou problèmes reproductifs.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de huit utilisations bénéfiques altérées restantes et de trois autres nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer une surveillance de la qualité de l’eau et des algues afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Déterminer l'état des populations de poissons afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de satisfaire aux critères de retrait de la liste;
- Effectuer une surveillance de l'esthétique afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de satisfaire aux critères de retrait de la liste;
- Effectuer une surveillance des tumeurs de foies de poissons afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de satisfaire aux critères de retrait de la liste;
- Élaborer une approche pour évaluer l’état de dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton;
- Effectuer des évaluations de l'état, s'il y a lieu, préparer des rapports d'évaluation de l'état et procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons etd'espèces sauvages, la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation de l'esthétique, la dégradation du benthos, les restrictions des activités de dragage, l'eutrophisation ou les algues indésirables, la fermeture de plages, la perte de l'habitat du poisson et d'autres espèces sauvages; et une désignation pour trois nouvelles utilisations bénéfiques exigeant une évaluation approfondie : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton, tumeurs ou autres malformations des poissons et malformations des oiseaux ou des animaux ou problèmes reproductifs.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l'utilisation bénéfique :
- Fournir un soutien technique et financier aux mesures prioritaires pour faire progresser les progrès vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour la perte d'habitat du poisson et de la faune et la dégradation des populations de poissons et d’animaux sauvages;
- Continuer à promouvoir le financement des infrastructures de la station d'épuration des eaux usées de Dundas afin de réduire les apports de phosphore dans Cootes Paradise, ainsi que poursuivre le financement actuel pour l'achèvement des améliorations tertiaires de la station d'épuration des eaux usées de Woodward Avenue afin de progresser vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour l'eutrophisation ou les algues indésirables.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique;
- Achèveront le projet d'assainissement des sédiments du récif de Randle afin de progresser vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour la dégradation du benthos.
Le Canada :
- Dirigera et mènera à bien le projet d'assainissement des sédiments du récif Randle conformément à l'accord de financement de subvention pour le projet d'assainissement des sédiments contaminés du récif Randle entre le Canada et l'Ontario et conformément aux accords du Canada avec la ville de Hamilton, l'autorité portuaire de Hamilton Oshawa, Stelco, la ville de Burlington et la municipalité régionale de Halton.
- Surveillera l'air, les sédiments en suspension et l'eau pendant la mise en œuvre du projet d'assainissement des sédiments du récif Randle afin d'assurer un impact environnemental minimal ou nul pendant l'assainissement;
- Effectuera une surveillance (poissons et faune, benthos, qualité de l'eau) pendant et après l'assainissement afin de déterminer l'efficacité du projet par rapport aux critères de retrait de la liste;
- Fournira un soutien technique et des conseils d'experts pour le projet;
- Transférera la propriété, l'exploitation, l'entretien et la surveillance à long terme à l'administration portuaire de Hamilton-Oshawa.
L’Ontario :
- Appuiera les mesures visant à rétablir une communauté de poissons saine et fonctionnelle afin d'atteindre les critères de retrait de la liste; pour la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages;
- Continuera à fournir un soutien financier pour la mise en œuvre du projet d'assainissement des sédiments du récif Randle;
- Assurera la surveillance règlementaire de la gestion des sédiments contaminés aux glissades de Strathearne et de Kenilworth.
Résultat 12 – Poursuivre la mise en œuvre des mesures requises pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir cinq utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de Toronto et de la région : restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, fermeture des plages, eutrophisation ou algues indésirables et perte de poissons et d'habitats fauniques; et déterminer l'état d'une autre utilisation bénéfique qui nécessite une évaluation supplémentaire : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de cinq utilisations bénéfiques altérées restantes et d'une autre nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer une analyse des populations d’animaux sauvages afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Déterminer l'état des populations de poissons afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Effectuer une surveillance de la qualité de l’eau afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Élaborer une approche pour évaluer l'état de la dégradation des utilisations bénéfiques des populations de phytoplancton et de zooplancton;
- Effectuer des évaluations de l'état, s'il y a lieu, préparer des rapports d'évaluation de l'état et procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, l'eutrophisation ou les algues indésirables, la fermeture des plages et la perte de poissons et d'habitats sauvages; et une désignation pour une utilisation bénéfique nécessitant une évaluation approfondie : Dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l’utilisation bénéfique :
- Fournir un soutien technique et financier aux projets de restauration de l'habitat afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages et la dégradation des poissons et animaux sauvages;
- Continuer à promouvoir le financement des projets d'infrastructure de la rivière Don et du Central Waterfront, qui comprennent la modernisation de la station d'épuration d'Ashbridges Bay, qui sont nécessaires pour réduire les débordements des égouts unitaires, améliorer la qualité de l'eau et progresser vers l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les fermetures de plages et l'eutrophisation ou les algues indésirables;
- Fournir des conseils techniques concernant le projet de naturalisation de la rivière Don et le projet de protection contre les inondations de Portlands afin de progresser vers l’atteinte des critères de retraite de la liste pour la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique.
L’Ontario :
- Appuiera les mesures visant à rétablir une communauté de poissons saine et fonctionnelle afin de satisfaire aux critères de retrait de la liste pour la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages.
Résultat 13 – Compléter les mesures requises pour respecter les critères de retrait de la liste et rétablir la seule utilisation bénéfique qui demeure altérée et retirer de la liste le SP du port de Port Hope : Restrictions sur les activités de dragage.
Le Canada :
- Évaluera l'état d'une altération de l'utilisation bénéfique restante :
- Compléter les évaluations de l'état, préparer les rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à la nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions des activités de dragage.
- Prendra des mesures correctives pour atteindre les critères de retrait de la liste des altérations de l’utilisation bénéfique :
- Dans le cadre de l'initiative fédérale de la région de Port Hope, continuer à diriger le financement, la planification, la consultation et l'engagement, la surveillance et la mise en œuvre des mesures correctives pour enlever et gérer en toute sécurité les sédiments contaminés du port de Port Hope.
Résultat 14 – Compléter les mesures restantes pour atteindre les critères de retrait et rétablir cinq utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP de la baie de Quinte : restrictions sur la consommation des poissons et de la faune, dégradation de l'esthétique, eutrophisation ou algues indésirables, dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton et restrictions sur la consommation d'eau potable, ou problèmes de goût et d'odeur.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de cinq autres altérations des utilisations bénéfiques :
- i.Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Effectuer une analyse des conditions esthétiques afin d'évaluer les progrès réalisésdans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Élaborer une approche pour affiner les critères de retrait de la liste pour la dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à une nouvelle désignation de l'altération de l'utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation des poissons et des animaux sauvages, la dégradation de l’esthétique, des algues indésirables ou eutrophisées, la dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
Le Canada et l’Ontario :
- Par l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion du phosphore de la baie de Quinte, continueront à progresser vers la réalisation des critères de retrait de la liste pour l'eutrophisation ou les algues indésirables;
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique, en désignant le SP comme SP en voie de rétablissement ou en retirant ce SP de la liste des SP.
Résultat 15 –Compléter les mesures restantes nécessaires pour atteindre les critères de retrait de la liste et rétablir les cinq utilisations bénéfiques qui demeurent altérées dans le SP du fleuve Saint-Laurent : les restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, la fermeture des plages, l'eutrophisation ou les algues indésirables et la perte des habitats de poissons et d’animaux sauvages, et déterminer le statut des deux autres utilisations bénéfiques qui nécessitent une évaluation plus approfondie : les tumeurs ou autres malformations des poissons et la dégradation du phytoplancton et du zooplancton.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront l'état de cinq utilisations bénéfiques altérées et de deux autres nécessitant une évaluation plus poussée :
- Améliorer la compréhension des habitudes de consommation de poisson afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour les restrictions de consommation de poissons et d’animaux sauvages;
- Évaluer les terres humides d'importance provinciale pour soutenir le développement des stratégies et mesures locales et pour évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Élaborer une approche pour évaluer la dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton;
- Effectuer des évaluations de l'état, préparer des rapports d'évaluation de l'état et, s'il y a lieu, procéder à une nouvelle désignation des altérations de l’utilisation bénéfique pour les restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages, la dégradation des populations de poissons et d'animaux sauvages, la fermeture des plages, l'eutrophisation ou les algues indésirables, la perte des habitats aquatiques et sauvages, et une désignation des utilisations bénéfiques qui nécessitent une évaluation plus approfondie : les tumeurs ou autres malformations des poissons et la dégradation des populations de phytoplancton et de zooplancton.
L’Ontario :
- Mènera une surveillance des contaminants de poissons afin d’évaluer tout progrès dans la réalisation des critères de retrait de la liste pour des restrictions sur la consommation de poissons et d'animaux sauvages.
- Achèvera la surveillance de la qualité de l'eau dans les zones littorales restantes des affluents prioritaires afin d'évaluer les progrès réalisésdans l'atteinte des critères de retrait de la liste pour l'eutrophisation ou les algues indésirables.
Le Canada et l’Ontario :
- Surveilleront le rétablissement naturel des sédiments contaminés le long du secteur riverain de Cornwall :
- Surveiller l'efficacité du rétablissement naturel afin d'évaluer les progrès réalisésdans l'atteinte des critères de retrait de la liste;
- Fournir des conseils techniques aux organismes locaux sur l'application du protocole de contrôle administratif de la stratégie relative aux sédiments de Cornwall afin d'assurer une gestion adéquate des sédiments contaminés.
- Entreprendront un processus visant à faire participer les collectivités, les Premières Nations et les Métis à l'assainissement et à la prise de décisions en vue de l'élimination des altérations de l'utilisation bénéfique, en désignant le SP comme SP en voie de rétablissement ou en retirant ce SP de la liste des SP.
- Communiqueront, si nécessaire, avec les agences fédérales et étatiques des États- Unis sur les questions qui font progresser la restauration et le retrait de la liste de cette zone binationale préoccupante.
annexe 6 : aménagement panlacustre
L'objectif de la présente annexe est de faire progresser la restauration, la protection et la conservation des Grands Lacs grâce à la collaboration entre les compétences à l'échelle nationale et binationale et avec la collectivité des Grands Lacs, un lac à la fois.
Les plans d'aménagement panlacustre constituent un mécanisme pour évaluer et produire des rapports sur l'état de l'écosystème, déterminer les priorités scientifiques et en matière de gestion, mener des études et des activités de sensibilisation, et déterminer le besoin de mesures supplémentaires et faciliter leur mise en place. L'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs décrit un engagement à mettre à jour et en œuvre les plans d'aménagement panlacustre pour chacun des quatre Grands Lacs canadiens, y compris leurs grands réseaux hydrographiques de la rivière St. Marys, de la rivière Sainte-Claire, de la rivière Détroit, de la rivière Niagara et de la partie internationale du fleuve Saint-Laurent. Il comprend également des engagements pour élaborer des objectifs liés à l'écosystème des lacs et comporte une consultation en coopération avec la collectivité des Grands Lacs visant à évaluer le statut de chacun des Grands Lacs et à traiter les facteurs de stress environnementaux à l'échelle du lac.
Les zones littorales des Grands Lacs présentent une grande diversité biologique, fournissent de nombreux avantages et sont le point central de l'interaction humaine avec les Grands Lacs, mais subissent également d'énormes répercussions provenant de l'activité humaine. Le cadre pour les zones littorales fournira une base pour l'évaluation et la gestion des zones littorales, y compris les plages des Grands Lacs. Il sera fondé sur la science, tiendra compte des sources de stress potentiel et réel, et comprendra la surveillance et la production de rapports.
La présente annexe s'appuie sur les initiatives existantes et nouvelles dans les zones géographiques prioritaires de chacun des Grands Lacs et les soutient, afin d'aider à atteindre les objectifs écosystémiques et à faire face aux enjeux panlacustres et relatifs aux zones littorales, qui peuvent être mieux gérés à l'échelle du lac. Elle reconnaît les importantes contributions des systèmes naturels et d’agriculture afin d’atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau et de la santé de l’écosystème. Les engagements dans les autres annexes, comme ceux concernant les éléments nutritifs, les secteurs préoccupants, l'habitat et les espèces, et les polluants nocifs soutiennent également les objectifs de la présente annexe.
Les Grands Lacs sont la principale source d'eau potable de l'Ontario. La présente annexe comprend des engagements à mieux évaluer et aborder les menaces des sources d'eau potable en lien avec les efforts menés en vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine de l'Ontario ainsi qu'avec les politiques et programmes fédéraux en place. Les engagements durant la période d'application de l'Accord sont renforcés par des programmes fédéraux et provinciaux, tels que le plan d'action fédéral pour les sites contaminés et les efforts provinciaux d'assainissement des sites contaminés.
Résultat 1 – L'état de chacun des Grands Lacs, y compris les réseaux hydrographiques reliés, fait l'objet d'une évaluation et d'une production de rapport régulières, et les questions qu'il est préférable de traiter à l'échelle du lac sont coordonnées et mises en œuvre à l'échelle binationale par l'entremise de plans d'aménagement panlacustre et avec les agences et organisations nationales.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- De l'évaluation et de la production de rapports sur l'état de l'eau (caractéristiques physiques, chimiques et biologiques) et la santé de l’écosystème de chacun des Grands Lacs canadiens et de leurs voies interlacustres, y compris les menaces et tendances potentielles actuelles et futures;
- De l'identification de priorités concernant la recherche, la surveillance et la science pour l'évaluation des menaces potentielles actuelles et futures pour la qualité de l'eau et la santé de l’écosystème des lacs, y compris les changements climatiques, et pour l'identification de priorités pour soutenir les mesures d'aménagement;
- De mener des enquêtes scientifiques et de surveillance sur l’écosystème, des inventaires, des études et des activités de sensibilisation pour étayer les évaluations susmentionnées et les mesures d'aménagement;
- De l’identification et la coordination des mesures requises par les organismes gouvernementaux et la collectivité des Grands Lacs pour traiter les menaces prioritaires propres à chaque lac pour la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes lacustres et pour atteindre les objectifs relatifs à l'écosystème des lacs;
- Des recommandations du Canada relativement à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies binationales propres aux différents lacs pour répondre aux objectifs et aux menaces potentielles actuelles et futures pour la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des lacs qu'il serait préférable de traiter un lac à la fois;
- De la publication des plans d’aménagement panlacustre de chaque lac, sur une période de cinq ans à tour de rôle, de façon à ce que ces plans pour les lacs Supérieur, Huron (2022), Ontario (2023) et Érié soient terminés.
Résultat 2 – La collectivité des Grands Lacs est engagée dans la prise de décisions et de mesures visant à restaurer, à protéger et à conserver les lacs et voies interlacustres.
Le Canada et l’Ontario :
- Accroîtront les possibilités de participation à l'évaluation de l'état des lacs, à l'identification des priorités en matière de science et d'action et à la prise de mesures pour régler les problèmes propres aux lacs, notamment :
- Possibilités pour la collectivité des Grands Lacs d'examiner et de formuler des commentaires à diverses étapes du processus d'élaboration du plan d'aménagement panlacustre pour chaque lac;
- Élaborer un processus pour faire participer les Premières Nations et les Métis à l'évaluation de l'état des lacs, à l'identification des priorités scientifiques et des mesures à prendre et à la prise de mesures pour régler les problèmes propres à chaque lac, pour chaque Grand lac, au moyen des plans d'action et d'aménagement panlacustre;
- Possibilités pour la collectivité des Grands Lacs d'entreprendre des actions à l'appui du plan d'aménagement panlacustre.
Résultat 3 – Un cadre pour les zones littorales des Grands Lacs est élaboré et la mise en œuvre est entamée, en collaboration avec la collectivité des Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Termineront une évaluation des eaux riveraines des Grands Lacs d’ici mars 2022, qui comprendra :
- l'évaluation de l'état de la zone littorale canadienne des Grands Lacs;
- la détermination des zones littorales qui sont ou peuvent être soumises à un fort stress du fait de répercussions particulières ou cumulatives sur leur intégrité chimique, physique ou biologique;
- la détermination des zones littorales qui sont de grande valeur écologique;
- la détermination des zones littorales prioritaires pour les mesures de prévention, de restauration et de protection à une échelle appropriée pour appuyer des mesures d'aménagement;
- la détermination des facteurs de stress (y compris les changements climatiques), des causes, des sources de contamination pour les secteurs prioritaires.
- Maintiendront des programmes de surveillance qui recueillent les données nécessaires à l'évaluation des eaux littorales canadiennes des Grands Lacs (eaux littorales), notamment la qualité de l'eau et des sédiments, la composition des communautés d'invertébrés benthiques, la prolifération d’algues nuisibles et toxiques, la santé des terres humides côtières, la qualité de l'eau aux prises d'eau potable et les données relatives à la consommation de poisson;
- Partageront les données et les résultats des évaluations des eaux littorales avec la collectivité des Grands Lacs au moyen des documents de plan d'aménagement panlacustre et d'autres mécanismes;
- Maintiendront à jour les évaluations des zones littorales;
- Élaboreront et partageront des outils et des approches permettant aux collectivités et aux organisations d'utiliser les résultats de l'évaluation des eaux littorales pour prendre des mesures de restauration et de protection des eaux littorales;
- Étudieront l’utilisation des nouvelles technologies pour mieux comprendre les processus côtiers et la santé des écosystèmes.
Résultat 4 – Les initiatives et les mesures prioritaires propres aux lacs visant à répondre aux menaces actuelles et futures pour la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème, tel qu'il est indiqué dans les plans d'aménagement panlacustre, le cadre pour les zones littorales, la Stratégie relative aux Grands Lacs de l'Ontario et d'autres moyens.
Le Canada et l’Ontario :
- Prendront des mesures concernant le lac Ontario par l'entremise d'initiatives, telles que :
- Collaboration avec la partie ouest du lac Ontario;
- Initiative de planification et de grandes données du bassin versant du ruisseau Carruthers à la rivière Moira;
- Plan de gestion des toxiques de la rivière Niagara, y compris la surveillance et la biosurveillance de la qualité de l'eau de la rivière Niagara;
- Initiative de la Stratégie Saint-Laurent.
- Prendront des mesures concernant le lac Érié par l'entremise d'initiatives, telles que :
- Plan de gestion de l'eau de la rivière Grand et Initiative de remise en état du sud de la rivière Grand;
- L'approche des eaux partagées de la rivière Thames (Deshkan Ziibi) en ce qui concerne la qualité et la quantité de l'eau et la revitalisation des eaux claires;
- Plan canadien de gestion du lac Sainte-Claire;
- Le Niagara Coastal Community Collaborative.
- Prendront des mesures concernant le lac Huron par l'entremise d'initiatives, telles que :
- Lake Huron Georgian Bay Framework for Community Action (Cadre de la baie Georgienne du lac Huron concernant l'action communautaire);
- Campagne Healthy Lake Huron – Clean Waters, Clean Beaches (rive sud-est).
- Prendront des mesures concernant le lac Supérieur par l'entremise d'initiatives, telles que :
- Le plan directeur provisoire de l'aire marine nationale de conservation du lac Supérieur.
Résultat 5 – Les risques potentiels pour les sources d'eau potable des Grands Lacs sont déterminés et évalués et des mesures précoces sont mises en œuvre afin de gérer les risques.
Le Canada :
- Continuera de renforcer la protection des Grands Lacs en tant que source d'eau potable saine grâce à des mécanismes binationaux en place, de manière collaborative;
- Mettra en œuvre des politiques et des programmes fédéraux qui permettent de protéger l'eau potable saine provenant des Grands Lacs.
L’Ontario :
- Déterminera les zones sensibles et atténuera les risques pour l'eau potable;
- Fournira des ensembles de données, des études et de l'expertise pour soutenir la détermination et l’évaluation des questions et des menaces pour les sources d'eau potable;
- Tiendra à jour ou élaborera des programmes pour assurer l’éducation et la sensibilisation du public au sujet de la protection des sources d'eau potable, pour :
- Déterminer et soutenir des mesures visant à atténuer les menaces potentielles sur les eaux de source;
- Encourager la collaboration en matière de protection des sources d’eau potable.
Résultat 6 –Amélioration de la compréhension et de la mise en œuvre d'approches de gestion adaptative des stratégies de régularisation des débits sortants pour les Grands Lacs d'amont et les niveaux des lacs du réseau lac Ontario - fleuve Saint-Laurent.
Le Canada et l’Ontario :
- Amélioreront la compréhension du bilan hydrologique du bassin des Grands Lacs, y compris les apports, les précipitations, l'évaporation et le ruissellement du bassin versant, et les facteurs qui contribuent aux niveaux variables du lac et la relation avec d'autres lacs naturels;
- Continueront à explorer les possibilités de collaboration sur les stratégies de gestion adaptative au niveau du lac liées à la qualité de l'eau et à la santé de l'écosystème;
- Maintiendront et avanceront des plans de gestion adaptative proposés par la Commission mixte internationale pour le secteur supérieur des Grands Lacs et le système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
Résultat 7 – Activités scientifiques coordonnées par le Canada, l'Ontario et d'autres intervenants pour soutenir les priorités scientifiques déterminées pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Travailleront avec les États-Unis et d’autres groupes afin de soutenir une Initiative des sciences coopératives et de surveillance (ISCS) pour les lacs Supérieur, Huron, Érié et Ontario sur une base alternée quinquennale, en coordonnant les activités qui sont axées sur les priorités scientifiques définies par l'entremise des plans d'aménagement panlacustre;
- S'assureront que les accords requis sont en place pour l'échange efficace de données de renseignements en temps opportun.
Résultat 8 – Évaluation et établissement de rapports de l'état des Grands Lacs à l'aide d'indicateurs écosystémiques fondés sur des données scientifiques.
Le Canada et l’Ontario :
- Appuieront l'élaboration d'indicateurs en maintenant des programmes de surveillance, en fournissant des données et en préparant des rapports sur les indicateurs, le cas échéant, et encourageront d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales des Grands Lacs à en faire autant;
- Partageront les données et l'information relatives aux Grands Lacs par l'entremise de mécanismes en place comme des forums existants, des médias sociaux, les sites Web des organismes et des rapports, et étudieront de nouvelles occasions de communiquer efficacement l'information sur les tendances de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème des Grands Lacs;
- Exploreront des approches pour communiquer les conditions et les tendances de la santé des écosystèmes qui tiennent compte de la variabilité des conditions dans les lacs, comme le bassin ouest du lac Ontario.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- De la mise en place et du maintien d’une série d’indicateurs écosystémiques détaillés axés sur la science pour évaluer l'état des Grands Lacs, anticiper les menaces et mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs généraux et précis de l'Accord Canada- États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
- De l'élaboration d'une évaluation binationale complète de l'écosystème des Grands Lacs fondée sur des indicateurs environnementaux convenus.
Le Canada :
- Fournira au public, par le biais de cartographies ouvertes soutenues par l’initiative de la Plateforme géospatiale fédérale, un accès à guichet unique vers les données canadiennes des Grands Lacs pour faciliter l'accès, la visualisation, l'intégration et l'analyse des données qui appuient la prise de décisions fondées sur des données probantes dans tous les domaines prioritaires visés par l'Accord.
priorité – protection de l'habitat et des espèces
Cette priorité met l'accent sur la restauration, la protection et la conservation des habitats naturels et de la biodiversité des Grands Lacs. Des habitats et des communautés de poissons et d'espèces sauvages indigènes épanouis contribuent au bien-être social et à la vitalité économique du bassin des Grands Lacs. Malheureusement, de nombreuses activités humaines exercent des pressions sur l'écosystème et entraînent la perte ou la dégradation des habitats, la fragmentation des systèmes naturels, la réduction de la santé et de l’abondance des espèces indigènes, et les menaces que représentent les espèces envahissantes. Afin de répondre à ces enjeux, cette priorité comprend les annexes sur les espèces aquatiques envahissantes (EAE) et sur l'habitat et les espèces.
annexe 7 : espèces aquatiques envahissantes
L'objectif de la présente annexe est de s'assurer de la coopération et de la coordination des efforts visant à réduire la menace des espèces envahissantes aquatiques pour la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.
Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) constituent une menace environnementale et économique importante pour les écosystèmes et la biodiversité des Grands Lacs. Les EAE ont gravement endommagé les Grands Lacs en affrontant les espèces indigènes, en modifiant les réseaux trophiques et en dégradant les habitats essentiels des populations de poissons et d'espèces sauvages. Elles peuvent également dégrader la qualité de l'eau en augmentant les matières en suspension, en concentrant les toxines, en favorisant la croissance de la prolifération d'algues nuisibles et en modifiant les flux d’éléments nutritifs et d'énergie dans le réseau alimentaire. Les EAE menacent l'économie des Grands Lacs en affectant d'importantes industries comme le tourisme, la pêche récréative et commerciale et en perturbant l'approvisionnement en eau potable des municipalités, des centrales électriques et des industries.
Des progrès importants ont été réalisés pour prévenir l'introduction et la propagation d'EAE nuisibles dans le bassin des Grands Lacs par les Parties et des efforts complémentaires ont été déployés aux États-Unis. Par exemple, de nouveaux règlements provinciaux et fédéraux interdisent la possession de plusieurs EAE à risque élevé, dont les carpes asiatiques. Les efforts coordonnés de la province et de plusieurs organismes fédéraux en matière d'application de la loi ont donné lieu à plusieurs interceptions et poursuites fructueuses en vertu de ce règlement. De plus, la réglementation fédérale et les normes internationales visant les eaux de ballast ont contribué à prévenir les introductions par cette voie de transfert. Ces succès soulignent l'importance des efforts coordonnés et stratégiques des Parties pour régler cette question complexe.
En s'appuyant sur ce succès, la présente annexe comprend les résultats et les engagements suivants pour déterminer le risque de nouveaux EAE et les voies d'introduction possibles, s'assurer la mise en œuvre des règlements pour prévenir ou réduire la propagation des EAE, appuyer la détection précoce coordonnée et la réponse aux nouvelles invasions, améliorer l'ensemble des outils disponibles pour détecter, contrôler et gérer les EAE établies et renforcer les efforts de sensibilisation pour mobiliser la collectivité élargie des Grands Lacs. Ces activités sont appuyées par des engagements continus visant à améliorer la compréhension des répercussions des EAE sur l'écosystème des Grands Lacs et des effets des changements climatiques pour éclairer la prise de décisions sur les stratégies de gestion. Les mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation des EAE par le rejet des eaux de ballast des bateaux sont également abordées dans l'annexe sur les rejets des bateaux du présent accord.
Les EAE ne respectent pas les frontières et le succès de la prévention et du contrôle exige une coopération entre toutes les administrations au Canada et aux États-Unis. Les Parties feront également preuve de leadership en collaborant avec toutes les administrations du bassin des Grands Lacs pour veiller à ce que des règles et des normes uniformes soient en place et puissent être appliquées dans la pratique par l'industrie et le public. Ils continueront de coordonner la mise en œuvre du Plan d'action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes et du Plan stratégique de l'Ontario sur les espèces envahissantes. L'Ontario continuera d'appuyer les engagements pris par les gouverneurs et les premiers ministres des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent de travailler ensemble pour contrer les menaces que représentent les EAE pour nos eaux communes. Le Canada poursuivra son travail avec les États-Unis pour contrôler la lamproie marine par l'entremise de la Commission des pêcheries des Grands Lacs. Grâce aux efforts décrits dans la présente annexe, l'Ontario et le Canada collaboreront pour atteindre les objectifs et respecter les engagements de l'annexe sur les espèces aquatiques envahissantes de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
Résultat 1 – Les besoins en eau de ballast protègent l'écosystème du bassin des Grands Lacs contre le rejet des EAE par les bateaux.
Le Canada :
- Prendra en compte les directives et les normes de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, 2004, continuera à mettre en œuvre la réglementation sur les eaux de ballast au Canada et respecter les engagements en vertu de l'annexe 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
Résultat 2 – Évaluations coordonnées des risques liés aux nouvelles voies de transfert possibles des EAE et de nouvelles EAE afin d'éclairer les mesures de prévention, de surveillance et de contrôle.
Le Canada et l’Ontario :
- Établiront conjointement les priorités en matière d'évaluation des risques écologiques pour les nouvelles EAE potentielles et les voies de transfert afin d'appuyer au mieux la prévention des EAE, y compris les mesures réglementaires. Pour les espèces et les voies de transfert jugées hautement prioritaires, le Canada et l’Ontario entreprendront des évaluations des risques en tenant compte des impacts écologiques et socio- économiques. Les évaluations des risques seront coordonnées avec les organismes de gestion d'autres administrations au Canada et aux États-Unis, le cas échéant;
- Continueront à élaborer et à mettre en œuvre des outils et méthodologies scientifiques pour soutenir les évaluations des risques écologiques et socio-économiques pour les EAE et les voies de transfert connexes.
Résultat 3 – Des règlements, des politiques et des stratégies de gestion sont en place pour prévenir les EAE nouvelles et potentielles et pour réduire le risque de leur propagation.
Le Canada et l’Ontario :
- Évalueront et, au besoin, prendront des mesures pour donner des conseils sur les modifications éventuelles, qui pourraient être envisagées par leurs assemblées législatives respectives, aux lois, règlements et politiques fédéraux ou provinciaux applicables afin de combler les lacunes, le cas échéant, dans la prévention de l'introduction et de l'établissement de nouvelles EAE et d'assurer une responsabilité claire des organismes;
- Clarifieront les rôles et les responsabilités juridictionnels liés aux divers taxons afin d'assurer une responsabilisation claire des organismes;
- Poursuivront les efforts conjoints d'application des règlements en vigueur pour empêcher l'introduction des EAE, comme la carpe asiatique, dans le bassin des Grands Lacs par-delà les frontières et par les voies commerciales et autres.
Résultat 4 –Un contrôle efficace de la lamproie de mer résultant en la suppression de leurs populations à des niveaux cibles qui soutiennent les objectifs relatifs à la communauté de poissons dans tous les Grands Lacs.
Le Canada :
- Mettra en œuvre le programme de contrôle de la lamproie de mer, en collaboration avec les États-Unis, tel qu'il est coordonné par l'entremise de la Commission des pêcheries des Grands Lacs, afin de réduire l'abondance de la lamproie de mer à des niveaux cibles qui soutiennent les objectifs relatifs à la communauté de poissons dans tous les Grands Lacs;
- Mènera, facilitera ou contribuera, en collaboration avec des organismes des États-Unis, à des recherches sur les méthodes de lutte contre la lamproie marine et l'évaluation des populations afin d'optimiser les décisions qui ciblent les efforts de lutte, mettra au point des solutions de rechange aux lampricides, choisira des méthodes de lutte et évaluera l'efficacité des programmes pour assurer une gestion efficace et intégrée de la lamproie de mer;
- Collaborera avec toutes les instances concernées pour veiller à ce que la propagation et le contrôle de la lamproie de mer soient pris en compte dans les projets d'enlèvement des barrages, d'assainissement ou de passes migratoires. La planification de tout nouvel obstacle spécifique à la lutte contre la lamproie de mer tiendra compte de la connectivité de l'habitat aquatique et de la biodiversité.
Résultat 5 – Prévention des déplacements et de la propagation des EAE dans les affluents et dans les cours d'eau qui y sont reliés.
Le Canada et l’Ontario :
- Travailleront en collaboration lors de la planification de la construction de nouveaux barrages, de l'entretien des barrages existants et de l'enlèvement des barrages et des barrières en ce qui concerne les déplacements, la propagation et les problèmes de connectivité des EAE;
- Amélioreront la compréhension du déplacement possible des EAE dans les bassins versants, par les canaux et les connexions entre les bassins;
- Feront avancer la recherche et le développement, avec l’aide des organismes des États- Unis, des passes de poissons qui bloques la lamproie de mer ou d’autres EAE mais permettent le déplacement de poissons et d’autres organismes non envahissants.
Résultat 6 – Prise en compte appropriée de la possibilité de propagation des EAE lors de tout transfert ou utilisation des eaux.
Le Canada et l’Ontario :
- Tiendront compte et feront tout pour atténuer les risques de propagation des EAE lors de l’évaluation de tout transfert ou utilisation des eaux.
Résultat 7 – Des initiatives de détection précoce et d'intervention sont élaborées et mises en œuvre pour les eaux canadiennes, en complément de la planification nationale américaine, créant ainsi un cadre d'intervention à l'échelle du bassin.
Le Canada et l’Ontario :
- Mettront au point et maintiendront un cadre fédéral-provincial coordonné de détection précoce et d'intervention pour les eaux canadiennes pour les carpes asiatiques, qui est guidé par des évaluations des risques et qui comprend des programmes de détection, des protocoles de déclaration et des interventions coordonnées des organismes;
- Élaboreront des cadres fédéraux-provinciaux coordonnés de détection précoce et d'intervention rapide dans les eaux canadiennes pour les EAE, y compris l'élaboration de listes de surveillance, de protocoles de rapport et de surveillance, et de stratégies d'intervention;
- Collaboreront avec les organismes fédéraux et d'État des États-Unis par l'entremise de mécanismes clés, comme le Groupe de travail sur les EAE des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le Comité de l'annexe 6 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et le Comité régional de coordination pour la carpe asiatique, pour élaborer et promouvoir des Ententes sur l'aide mutuelle qui appuient des mesures de surveillance transfrontalière et des interventions dans le bassin en matière d'EAE.
Résultat 8 – Outils améliorés pour détecter, répondre et contrôler les EAE.
Le Canada et l’Ontario :
- Feront la promotion de la recherche et du développement de techniques novatrices visant à détecter et à surveiller les EAE dans les Grands Lacs et dans les voies de transfert, y compris le commerce et les loisirs;
- Feront la promotion de la recherche et de la mise au point d'outils de contrôle pour mieux réagir aux EAE et mieux les gérer;
- Exploreront les possibilités avec d'autres provinces et le gouvernement fédéral pour accroître la disponibilité des méthodes de lutte contre les espèces envahissantes dans les habitats aquatiques.
Résultat 9 – Meilleure compréhension des impacts des EAE et mise en œuvre d’une gestion fondée sur le risque ou de mesures d'adaptation.
Le Canada et l’Ontario :
- Effectueront des recherches pour évaluer les risques et appuieront l'établissement de priorités entre les EAE nouvelles et existantes dans les écosystèmes du bassin des Grands Lacs;
- Surveilleront et signaleront l'occurrence et l'état des EAE prioritaires, nouvelles et existantes, et leurs impacts sur les écosystèmes des Grands Lacs;
- Mettre en œuvre des stratégies de gestion fondées sur le risque, lorsque des EAE prioritaires sont établies et que l'éradication n'est pas réalisable, et prendront des mesures de contrôle et d'adaptation, le cas échéant.
Résultat 10 – Meilleure compréhension de l'impact des changements climatiques sur les EAE dans les Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Continueront à faire progresser la recherche afin de déterminer les changements potentiels dans la répartition des espèces et les risques associés aux nouvelles EAE en raison des effets des changements climatiques dans le bassin des Grands Lacs et intégreront les résultats dans des analyses des risques des nouvelles EAE et voies de transfert.
Résultat 11 – Meilleure sensibilisation et adoption de mesures par la collectivité des Grands Lacs pour prévenir l'introduction et la propagation des EAE.
Le Canada et l’Ontario :
- Feront progresser les priorités communes en matière de communication et de sensibilisation afin de faire participer la collectivité des Grands Lacs à la prévention de l'introduction et de la propagation des EAE;
- Encourageront la science citoyenne à soutenir la détection précoce et le suivi des EAE;
- Collaboreront avec les principaux partenaires pour élargir les réseaux de communication et renforcer l'impact collectif des activités de sensibilisation.
annexe 8 : habitats et espèces
L'objectif de la présente annexe est de poursuivre les efforts visant à restaurer, à protéger et à conserver la résilience des espèces indigènes des Grands Lacs et de leurs habitats.
Les Grands Lacs soutiennent une riche diversité de poissons, d'espèces sauvages et d'espèces végétales. Des habitats et des communautés de poissons et d'espèces sauvages indigènes épanouis contribuent au bien-être social et à la vitalité économique de la région des Grands Lacs. Malheureusement, de nombreuses activités humaines exercent des pressions sur l'écosystème et entraînent la perte ou la dégradation des habitats, la fragmentation des systèmes naturels, les menaces et les impacts des espèces aquatiques envahissantes (EAE) et la réduction de la santé et de l’abondance des espèces indigènes.
La présente annexe met l'accent sur les efforts de collaboration visant à restaurer, protéger et conserver la diversité des habitats et des espèces qui composent l’écosystème du bassin des Grands Lacs tout en offrant des avantages sociaux, écologiques et économiques durables.
Le Canada et l'Ontario soutiennent des initiatives stratégiques de planification de la conservation, comme la planification du patrimoine naturel, le Cadre national du réseau d'aires marines protégées au Canada et le plan d’aires marines nationales de conservations. La collaboration par l'entremise de la Commission des pêcheries des Grands Lacs facilite la gestion internationale partagée des pêches par l'entremise de mécanismes conformes au plan stratégique conjoint de gestion des pêches des Grands Lacs. Le Canada et l'Ontario collaborent aussi aux activités afin d'assurer la protection et le rétablissement efficaces des espèces en péril et de leurs habitats en Ontario.
Les efforts de collaboration décrits dans la présente annexe sont appuyés par d'autres annexes du présent accord. Les plans d'aménagement panlacustre et les plans d'action contiennent des mesures pour restaurer, protéger et conserver la biodiversité indigène. L'annexe 8 portera sur les composantes relatives à l'habitat et aux espèces de l'Initiative binationale des sciences coopératives et de surveillance (ISCS), telles que définies dans l'annexe sur l'aménagement panlacustre. L'évaluation des eaux littorales dans l'annexe sur l'aménagement panlacustre met l'accent sur les effets cumulatifs sur l'écosystème qui touchent l'habitat et les espèces. Les mesures de restauration de l'habitat et des populations de poissons et d'animaux sauvages dégradés sont incluses dans les plans de mesures correctives de l'annexe sur les secteurs préoccupants. Les EAE représentent une menace continue pour les espèces et les écosystèmes indigènes. Les mesures de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes se trouvent dans l'annexe sur les espèces aquatiques envahissantes et complètent les mesures de gestion visant à protéger et à restaurer les habitats qui y sont décrites. Les changements climatiques entraînent des changements dans les conditions physiques des Grands Lacs, comme la température, les précipitations, la couverture de glace et les niveaux d'eau, qui, à leur tour, affectent les habitats et les espèces. La recherche et les mesures d'adaptation sont incluses dans l'annexe sur les impacts et la résilience liés aux changements climatiques. Les mesures d'évaluation et d'amélioration de la résilience aux impacts du changement climatique sont incluses dans l'Annexe sur l'habitat et les espèces en ce qui concerne l'habitat et les espèces.
Les Parties continueront d'appuyer les programmes de recherche et de surveillance qui enquêtent sur les menaces pesant sur les habitats et les espèces aquatiques, déterminent les méthodes d'atténuation des menaces et priorisent les possibilités de restauration. Les Parties continueront d'utiliser les mécanismes de rapport existants (p. ex. les plans d'action et d'aménagement panlacustres) et d'autres moyens pour rendre compte des progrès réalisés à l'égard des engagements de l'Annexe sur l’habitat et les espèces.
Résultat 1 – Des habitats de haute qualité ayant besoin de protection, des secteurs prioritaires nécessitant la restauration et la création de l'habitat, et des facteurs de stress plus importants pour les espèces indigènes et les habitats sont désignés.
Le Canada et l’Ontario :
- Continueront à entreprendre une étude de base de l'habitat pour orienter les mesures de conservation durable et mesurer les progrès vers un objectif de gain net d'habitat en tenant compte de l'étendue, de l'état, des protections actuelles et des principales menaces et facteurs de stress pour chaque Grand Lac;
- Détermineront les habitats prioritaires à protéger et à restaurer afin de maintenir et d'accroître les populations d'espèces indigènes, y compris les espèces en péril, et d'améliorer la résilience des systèmes et processus naturels tout en tenant compte de l'écosystème général des Grands Lacs.
Résultat 2 – Une meilleure compréhension des vulnérabilités liées au climat et de la résilience des terres humides côtières des Grands Lacs.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- De la réalisation d’une évaluation scientifique de la vulnérabilité des zones humides côtières aux impacts liés au climat;
- De la définition des mesures d'adaptation et élaborera des orientations pour renforcer la résilience des zones humides.
Résultat 3 – L'habitat et les espèces indigènes des Grands Lacs sont protégés, améliorés ou restaurés pour préserver la santé de l'écosystème.
Le Canada et l’Ontario :
- Mettront en œuvre des mesures de collaboration binationales, guidées par les objectifs des communautés de poissons, pour appuyer une gestion qui réduit la perte d'espèces indigènes telles que :
- Lac Supérieur : omble de fontaine, esturgeon jaune et doré;
- Lac Huron : esturgeon jaune, touladi et doré jaune;
- Lac Érié et lac Sainte-Claire : esturgeon jaune et touladi;
- Lac Ontario et fleuve Saint-Laurent : touladi, saumon atlantique, anguille d'Amérique, esturgeon jaune;
- Autres espèces clés à identifier.
- Collaboreront avec la collectivité des Grands Lacs pour conserver et restaurer l'habitat prioritaire au moyen de mesures d'intendance, de pratiques de gestion bénéfiques, d'incitatifs fiscaux ou d'autres programmes (p. ex. Fonds canadien pour la nature, Programme des dons écologiques) ou de mesures conformes aux plans et stratégies gouvernementaux;
- Conserveront et protègeront l’habitat des poissons et les poissons des Grands Lacs au moyen des lois et des politiques fédérales et provinciales actuelles et éventuelles, afin de contribuer à la santé des écosystèmes aquatiques, à l'approvisionnement en poissons sains destinés à la consommation humaine et à la création et à l'amélioration des possibilités de pêche;
- Appuieront des mesures prioritaires pour restaurer ou améliorer la connectivité des poissons migrateurs avec les affluents des Grands Lacs afin d’assurer des progrès constants dans la conservation des espèces indigènes;
- Mettront en œuvre des mesures pour restaurer, protéger et conserver les habitats de la sauvagine, des oiseaux aquatiques et des oiseaux de rivage des Grands Lacs dans le cadre du Plan conjoint des habitats de l'Est et de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord, conformément aux stratégies de gestion nationales et internationales;
- Feront la promotion de l'utilisation des habitats en tant qu'infrastructures naturelles en reconnaissant leur rôle dans la protection des personnes et des biens contre les risques naturels et anthropiques ainsi que dans l'atténuation des effets des changements climatiques;
- Renforceront la protection à long terme de la biodiversité et la restauration des écosystèmes grâce à un réseau d'aires protégées aquatiques et terrestres;
- Entreprendront et appuieront la recherche, la surveillance et l'établissement de rapports sur l'état, l'utilisation et la valeur des ressources naturelles des Grands Lacs, en mettant l'accent sur les poissons indigènes, la faune aquatique dépendante, les réseaux alimentaires aquatiques et les habitats;
- Entreprendront et appuieront des études sur le fonctionnement et les services écosystémiques des zones humides, notamment l'hydrologie, la qualité et la quantité de l'eau, les capacités de réduction du phosphore, la séquestration du carbone et l'habitat du poisson et de la faune.
Le Canada :
- Mettra en œuvre un programme de protection du poisson et de son habitat qui protège le poisson et son habitat contre les dommages, conformément aux objectifs de gestion des pêches et à la planification des Grands Lacs.
Résultat 4 –Une collectivité des Grands Lacs informée et engagée qui participe à la restauration, à la protection et à la conservation de la résilience des espèces et des habitats indigènes et à leur utilisation durable.
Le Canada et l’Ontario :
- Feront la promotion des activités d'intendance de la communauté des Grands Lacs par le biais de possibilités de transfert technique, telles que des ateliers, du matériel de vulgarisation ou de la formation et par des initiatives nationales et provinciales;
- Partageront avec la communauté des Grands Lacs des informations sur l'étude de base de l'habitat et l'importance pour les espèces indigènes et leur conservation;
- Établiront un consensus et feront la promotion de la mise en œuvre d'actions avec la communauté des Grands Lacs sur les priorités et les stratégies visant à renforcer la résilience des zones humides côtières.
priorité – amélioration de la compréhension et de l'adaptation
Cette priorité est axée sur l'amélioration de la compréhension des changements climatiques et de l'eau souterraine afin de faire progresser l'adaptation, d'éclairer les décisions de gestion des Grands Lacs et de déterminer les priorités d'action. L'annexe sur la qualité des eaux souterraines comprend des engagements visant à améliorer la compréhension des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface et leur influence sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l'écosystème. L'Annexe sur les impacts et la résilience liés aux changements climatiques comprend des initiatives visant à faire progresser les connaissances sur les impacts des changements climatiques, à évaluer les risques et les vulnérabilités liés aux changements climatiques dans le bassin des Grands Lacs et à mieux préparer les collectivités à s'adapter et à renforcer leur résilience.
annexe 9 : qualité des eaux souterraines
La présente annexe vise à obtenir une meilleure compréhension de la façon dont les eaux souterraines influencent la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs et à déterminer les zones prioritaires pour les mesures à venir.
Les eaux souterraines représentent jusqu'à 40 % de l'eau entrant dans les Grands Lacs, soit directement (par l'écoulement des eaux souterraines le long des côtes) ou indirectement (par l'intermédiaire de déversement dans les rivières et les cours d'eau qui se jettent ensuite dans les lacs). Par conséquent, le débit continu d'eau souterraine de bonne qualité joue un rôle important dans la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Les contaminants provenant des eaux souterraines et des quantités excessives d'éléments nutritifs peuvent nuire à la qualité de l'eau des Grands Lacs, en particulier dans la région littorale, et entraîner des effets potentiels sur les espèces aquatiques, les eaux utilisées à des fins récréatives et les approvisionnements en eau.
Étant donné que les eaux souterraines constituent une source importante d’eau et une source potentielle de contaminants et de quantités excessives d'éléments nutritifs et sont une voie de transfert vers les Grands Lacs, la qualité des eaux souterraines est liée à la mise en œuvre réussie des engagements clés des autres annexes, y compris les secteurs préoccupants, les polluants nocifs, l'aménagement panlacustre, les polluants nocifs, les éléments nutritifs, et l'habitat et les espèces.
Certaines zones près des Grands Lacs sont connues pour leurs eaux souterraines contaminées. Dans certains cas, des initiatives sont en cours pour la gestion directe ou des mesures d'assainissement dans ces emplacements. Elles comprennent les efforts provinciaux d'assainissement des sites contaminés comme le site minier Deloro, et une partie du travail accompli par l'entremise du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux et l'assainissement de la région de Port Hope mené par le gouvernement fédéral. Ces mesures protégeront ou amélioreront la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
La présente annexe comprend l'engagement de mettre à jour un rapport scientifique binational sur l'état des eaux souterraines, de déterminer les priorités en matière de recherche future et de déterminer les secteurs et les sites prioritaires pour les mesures de surveillance, de gestion ou d'assainissement pour aborder les répercussions et les facteurs de stress reliés aux eaux souterraines.
Résultat 1 – Une stratégie binationale sur les sciences des eaux souterraines, fondée sur la collecte et la compilation de résultats scientifiques relatifs aux eaux souterraines, est mise à jour et mise à disposition.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- De la mise à jour, d’ici 2022 et en collaboration avec les États-Unis, de l’état binational du rapport de 2016 sur la science des eaux souterraines en faisant la synthèse des connaissances scientifiques pertinentes et disponibles sur les eaux souterraines;
- De réunir des compétences scientifiques et techniques pour :
- Mettre à jour l’état de la science des eaux souterraines en ce qui a trait aux répercussions sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l'écosystème des Grands Lacs;
- Désigner les priorités relatives à la science des eaux souterraines.
Résultat 2 – Meilleure compréhension des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface et de leur influence sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l'écosystème pour éclairer les mesures et les décisions de gestion.
Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :
- D’appuyer l'élaboration de modèles conceptuels et numériques des eaux de surface et des eaux souterraines à l'échelle des Grands Lacs, des bassins, des bassins versants et des aquifères;
- D’entreprendre et de faire la promotion de la surveillance et de la recherche afin de mieux comprendre l'influence des eaux souterraines sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.
L’Ontario :
- Maintiendra la surveillance provinciale des eaux souterraines, des eaux de surface et des changements climatiques et utilisera ces données pour mettre à jour la contribution de l'Ontario à l'indicateur binational de l'écosystème des eaux souterraines des Grands Lacs et explorera les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface.
Résultat 3 – Meilleure compréhension des impacts des eaux souterraines et des facteurs de stress sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs et détermination des secteurs prioritaires pour l'élaboration de mesures de surveillance, de gestion ou d'assainissement.
Le Canada et l’Ontario :
- Faciliteront la coordination, le partage et l'échange d'informations et de travaux de recherche afin de mieux comprendre les incidences des eaux souterraines sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs;
- Désigneront les sites ou les zones prioritaires où les sources ponctuelles peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, y compris les zones littorales.
annexe 10 : résilience et répercussions des changements climatiques
L'objectif de la présente annexe est de continuer de renforcer la compréhension des répercussions des changements climatiques, de faire progresser l'intégration de ces connaissances dans les stratégies d'adaptation et les mesures de gestion des Grands Lacs et d’aider les collectivités à construire une résilience climatique.
Les répercussions des changements climatiques sont en cours d'observation dans le bassin des Grands Lacs. Certaines des répercussions les plus évidentes comprennent la hausse de température de l’eau, la modification des schémas de précipitations, la variabilité extrême du niveau des lacs, la diminution de la couverture de glace, une augmentation de l'évaporation du lac ainsi que des phénomènes météorologiques extrêmes.
Les efforts nationaux visant à aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques complètent les engagements pris en vertu de la présente annexe. Le programme d'Adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada facilite l'élaboration et l'échange d'information, de connaissances et d'outils nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de mesures pratiques visant à accroître la résilience au climat. Ce programme appuie la planification, la prise de décisions et les mesures d'adaptation régionales dans le but d'aider les collectivités et l'industrie à se préparer et à s'adapter aux répercussions locales découlant des changements climatiques, comme l'augmentation des sécheresses, des inondations, de l'érosion côtière et des tempêtes de neige et de verglas. Le Canada travaille également avec de nombreux partenaires pour améliorer sa capacité de prévoir et de gérer les risques d'inondation.
Les programmes et les efforts de l'Ontario en matière de changements climatiques appuieront les engagements de la présente annexe. Il s'agit notamment d'améliorer notre compréhension des répercussions des changements climatiques en investissant dans des prévisions en matière de changement climatique à l'échelle régionale à l'aide des données les plus récentes du modèle climatique mondial. L'Ontario entreprend également une évaluation provinciale des répercussions des changements climatiques afin d'aider davantage les collectivités, les entreprises et les municipalités, y compris celles du bassin des Grands Lacs, à cerner les vulnérabilités et les répercussions dans toute la province. De plus, l'Ontario est en train de mettre au point un outil en ligne pour appuyer le partage de l'information en mettant à la disposition des secteurs public et privé des renseignements pratiques sur les changements climatiques. L'Ontario continuera à travailler avec ses partenaires dans toute la province pour appuyer le leadership local et pour acquérir des connaissances sur l'adaptation aux changements climatiques.
Le changement climatique affecte les processus physiques, chimiques et biologiques et les écosystèmes aquatiques des Grands Lacs. Cela a également des répercussions sur les gens, la santé publique, les collectivités et l'infrastructure dans le bassin des Grands Lacs. Par exemple, le réchauffement de la température de l'eau peut entraîner une prolifération accrue d'algues, des changements dans les taux de productivité biologique et des effets sur la qualité de l'eau. Les niveaux d'eau extrêmes posent des risques importants pour les Grands Lacs, notamment des répercussions sur la qualité de l'eau et les fonctions des écosystèmes (voir aussi les annexes sur les éléments nutritifs, les polluants nocifs, l'aménagement panlacustre et les eaux souterraines).
Les changements dans les régimes de précipitations peuvent influer sur les processus littoraux et accroître la concentration d'éléments nutritifs, ce qui peut à son tour accroître les proliférations d'algues nuisibles; et les habitats, les populations et la diversité des poissons et de la faune indigènes peuvent être touchés par des changements dans le fonctionnement des écosystèmes et par de nouvelles espèces envahissantes (voir aussi les annexes sur les espèces aquatiques envahissantes et sur les habitats et les espèces).
La présente annexe contient des engagements qui permettront d'améliorer notre compréhension des répercussions des changements climatiques sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs; d'évaluer les vulnérabilités et les risques actuels et futurs liés aux changements climatiques; de faire progresser l'intégration des considérations relatives aux changements climatiques dans les stratégies de gestion des Grands Lacs; de partager l'information sur le changement climatique avec la collectivité des Grands Lacs, notamment les décideurs et les gestionnaires des ressources; d'aider les collectivités à renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques et à mieux y réagir.
Résultat 1 – Amélioration des connaissances et de la compréhension des répercussions actuelles et futures des changements climatiques dans les Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Maintiendront la surveillance des niveaux d'eau des Grands Lacs et de l'écoulement fluvial, par l'entremise du réseau hydrométrique de l'Ontario à frais partagés et des travaux binationaux avec des organismes fédéraux et étatiques des États-Unis;
- Collaboreront avec d'autres pour appliquer la recherche et la modélisation climatiques au niveau national aux projections à l'échelle régionale concernant les éléments du changement climatique tels que la température de l'air et de l'eau, la vitesse des vents, la glace, l'humidité, le débit, la fréquence, la durée et l'intensité des précipitations, les déplacements saisonniers, dans la mesure du possible.
Le Canada :
- Maintiendra la surveillance des variables relatives au climat et aux conditions météorologiques, comme le vent, la température, les précipitations, l'évaporation, la hauteur des vagues, la température de l'eau, la couverture de glace et les niveaux d’eau dans les Grands Lacs;
- Améliorera la compréhension des tendances et variations climatiques observées et de leurs effets sur les processus physiques, chimiques et biologiques affectant les Grands Lacs;
- Appuiera la coordination de la surveillance des Grands Lacs par radar à synthèse d'ouverture dans le cadre de la mission de la Constellation RADARSAT.
L’Ontario :
- Travaillera en collaboration avec les milieux universitaires et d'autres acteurs pour mettre à jour les projections climatiques à l'échelle régionale en utilisant les données les plus récentes des modèles climatiques mondiaux;
- Partagera les projections régionales à plus petite échelle des données disponibles sur les changements climatiques pour le bassin des Grands Lacs en Ontario;
- Maintiendra les réseaux provinciaux de surveillance de la qualité de l'eau des cours d'eau et de la quantité et de la qualité des eaux souterraines dans le bassin des Grands Lacs;
- Exploitera et améliorera les stations de surveillance intégrées existantes afin de mieux comprendre comment les changements climatiques influent sur les eaux souterraines et les cours d'eau qui pourraient alimenter les Grands Lacs en éléments nutritifs et en contaminants;
- Dans le cas du lac Ontario, étendra la couverture saisonnière de la surveillance de la qualité de l'eau pour tenir compte des événements extrêmes et de ceux qui surviennent en hiver.
Résultat 2 – Évaluer les risques et les vulnérabilités actuels et futurs liés aux changements climatiques dans les Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- S'appuieront sur les évaluations nationales et provinciales des répercussions des changements climatiques et étudieront la possibilité d'élaborer une évaluation Canada- Ontario des répercussions des changements climatiques dans les Grands Lacs;
- Tiendront compte des effets des changements climatiques et des conditions climatiques changeantes dans l'élaboration des stratégies de gestion et des plans d'action prévus par l'Accord;
- Appuieront l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales de gestion adaptative des Grands Lacs axées sur les répercussions sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, y compris les initiatives liées aux incertitudes, vulnérabilités et risques liés au niveau des lacs;
- Évalueront la vulnérabilité des espèces et des écosystèmes aquatiques aux changements climatiques prévus, y compris les tendances et les variations de la température et de la couverture de glace.
Le Canada :
- Améliorera les modèles et les outils d'analyse à l'échelle régionale (p. ex. les courbes d'intensité, de durée et de fréquence, les analyses des niveaux d'eau, des vents et des vagues) afin de mieux comprendre les risques, la vulnérabilité et les possibilités associés aux incidences des changements climatiques sur les Grands Lacs;
- Appuiera la province, celle en charge des inondations et de l'atténuation des inondations, à mesure que l'Ontario oriente les municipalités qui utilisent les lois et les directives techniques établies vers la poursuite des progrès dans l'identification des zones exposées aux risques naturels, et appuiera l'utilisation des cartes des plaines inondables par les municipalités pour informer leurs obligations législatives en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Résultat 3 – Partager l'information sur les impacts, les risques et les vulnérabilités liés aux changements climatiques avec la collectivité des Grands Lacs et faire progresser l'intégration des considérations relatives aux changements climatiques dans les stratégies de gestion des Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Partageront avec les organismes, les organisations et les collectivités des Grands Lacs les données et les informations relatives au climat et aux effets des changements climatiques, y compris les résultats des modèles climatiques à l'échelle régionale et les résultats des recherches, qui ont des répercussions sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé des écosystèmes;
- Communiqueront les progrès scientifiques, les stratégies et les mesures en cours pour contrer les répercussions des changements climatiques dans les Grands Lacs;
- Partageront les données et l'expertise sur les niveaux d'eau et les bilans hydriques des Grands Lacs, dans la mesure du possible, en ce qui concerne la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs, afin de promouvoir la compréhension des répercussions des changements climatiques et de faire progresser les mesures d'adaptation aux changements climatiques; et
- Partageront les informations et les résultats de l’évaluation provinciale de l’impact des changements climatiques et la série de rapports « Le Canada dans un climat en changement ».
Résultat 4 - Les collectivités sont mieux préparées à s'adapter aux changements climatiques et à renforcer leur résilience.
Le Canada et l’Ontario :
- Travailleront avec d’autres pour augmenter la capacité de mise en œuvre des mesures d’adaptation, et feront la promotion de l’utilisation d’outils de gestion adaptative dans le bassin des Grands Lacs;
- Exploreront des possibilités d'aider les collectivités des Grands Lacs à tenir compte des répercussions des changements climatiques sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs, notamment l'érosion des rives, la sécheresse et les inondations, dans le cadre de la planification de l'adaptation communautaire et des initiatives visant à renforcer la résilience des collectivités;
- Travailleront par l'entremise du Comité sur les politiques d'adaptation du Conseil canadien des ministres de l'environnement afin de faire progresser les travaux sur l'adaptation, y compris les travaux liés aux infrastructures naturelles, l'évaluation des risques associés aux changements climatiques et la mesure des progrès.
L’Ontario :
- Entreprendra un ensemble d’initiatives locales (municipales et communautaires), de planification et de lutte contre les changements climatiques qui ont été réalisées ou qui sont en cours dans le bassin des Grands Lacs.
priorité – engagement des collectivités – de la sensibilisation aux mesures
Cette priorité se concentre sur la création de possibilités pour les collectivités afin de participer à des efforts permettant d’améliorer la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème, tout en contribuant au bien-être de la collectivité des Grands Lacs. Les Grands Lacs procurent de nombreux avantages au bien-être social et économique des gens qui vivent le long de leurs rives et dans les bassins versants. En favorisant l'action communautaire pour garder les Grands Lacs propres et sains, les générations à venir pourront continuer à profiter des nombreux avantages et de la prospérité qu'ils apportent. Trois annexes traitent des moyens d'accroître et de maintenir ces avantages : De la sensibilisation aux mesures, les Métis et les Grands Lacs et les Premières Nations et les Grands Lacs.
annexe 11 : de la sensibilisation aux mesures
L’objectif de la présente annexe est d'offrir aux collectivités locales des possibilités d'action pour la restauration, la protection et la conservation des Grands Lacs.
Les Grands Lacs sont un élément essentiel de la vie quotidienne des gens qui vivent le long de leurs rives et dans les bassins versants. Ils fournissent l'eau potable, la nourriture et l'électricité, et modèrent notre climat. Ils offrent des possibilités de loisirs et de tourisme et nous relient à notre patrimoine. Leur beauté naturelle nourrit notre esprit. Ils constituent l'épine dorsale économique de l'Ontario. S'assurer que les Grands Lacs sont en santé et que les ressources sont gérées de façon durable est d'une importance vitale tant pour les lacs que pour les gens qui y vivent et y travaillent.
Malgré les nombreux avantages de la vie dans le bassin des Grands Lacs, de nombreux habitants ne sont pas conscients des liens qui existent entre leurs activités, leur qualité de vie et la santé des lacs. Chacun a un rôle à jouer dans la protection, la restauration et la conservation des lacs par des actions locales. L'amélioration de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation à l'égard des Grands Lacs accroîtra leur appréciation globale et motivera les gens à s'impliquer. L'action communautaire locale aidera à restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs tout en s'efforçant de prévenir l'apparition de nouveaux problèmes et de profiter pleinement de toutes les possibilités qu'offrent les Grands Lacs. Un engagement accru de la collectivité des Grands Lacs, de tous les secteurs, contribuera à l'atteinte des résultats communs aux Grands Lacs.
Le Canada et l'Ontario ont mis en place plusieurs initiatives visant à accroître la sensibilisation et à appuyer les initiatives communautaires locales, et continueront à faire participer la collectivité des Grands Lacs dans le cadre d'une bonne gouvernance. La collectivité des Grands Lacs contribue depuis longtemps à la restauration, à la protection et à la conservation des lacs. La présente annexe vise à poursuivre ces efforts et à inclure un large éventail de Canadiennes et Canadiens dans le dialogue, la planification et l'établissement des priorités, ainsi que dans les activités de sensibilisation, d'élargissement des expériences et d'encouragement à l'action sur les questions relatives aux Grands Lacs.
Résultat 1 – Accroître l'engagement de la collectivité des Grands Lacs en établissant des priorités et en travaillant en partenariat à la réalisation des engagements pris dans le cadre de l'Accord.
Le Canada et l’Ontario :
- Accroîtront la sensibilisation et la connaissance des Grands Lacs et la participation à leur protection par l'utilisation de plates-formes de participation en ligne et de médias sociaux; les rapports sur l'état des Grands Lacs; les plans d'action et d'aménagement panlacustres; les mesures visant à restaurer les secteurs préoccupants; l'application du plan d'action du lac Érié et autres activités;
- Relieront et inspireront les visiteurs du parc, les résidents des collectivités avoisinantes et les étudiants aux Grands Lacs au moyen d'activités et de programmes dans les parcs provinciaux et nationaux, les aires marines nationales de conservation et les aires protégées (p. ex. le Programme de découverte de Parcs Ontario, l'initiative Santé des parcs santé des populations), et en leur offrant la possibilité de participer aux activités de gérance, aux initiatives scientifiques citoyennes et aux loisirs axés sur la nature durable.
Le Canada :
- Organisera un forum public binational sur les Grands Lacs pour discuter de l'état des lacs et des priorités binationales en matière de science et d'action, tout en recevant des commentaires à ce sujet;
- Appuiera l'engagement accru du public à l'égard des questions relatives aux Grands Lacs grâce à la science citoyenne dans le cadre de l'Initiative de protection des Grands Lacs;
- Encouragera et appuiera les projets et les initiatives communautaires visant à restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs grâce à l'Initiative de protection des Grands Lacs et au Programme de financement communautaire ÉcoAction.
L’Ontario :
- Encouragera et soutiendra les projets communautaires qui prennent des mesures pour aider à restaurer, protéger, conserver et faire connaître les Grands Lacs, y compris les projets qui s'attaquent à des problèmes spécifiques, tels que le renforcement de la résilience climatique, la lutte contre la pollution plastique et le nettoyage des déchets, la réduction des excès de sel routier, la réduction de la prolifération des algues toxiques et autres problèmes;
- Collaborera avec les conseils scolaires, les administrateurs scolaires et les enseignants pour appuyer l'utilisation de modèles éprouvés et d'autres possibilités qui utilisent les Grands Lacs comme contexte d'enseignement et d'apprentissage;
- Fera mieux connaître et apprécier les Grands Lacs en communiquant le rapport d'étape de la Stratégie relative aux Grands Lacs de l'Ontario, l'examen de la Stratégie et d'autres mécanismes, et convoquera une réunion du Conseil de protection des Grands Lacs au moins une fois par année pour discuter des priorités d'action pour les Grands Lacs.
Résultat 2 – Croissance économique liée aux possibilités découlant du tourisme et des loisirs durables qui dépendent des Grands Lacs.
L’Ontario :
- Désignera les possibilités de participation, les liens et les gains d'efficacité pour mieux mettre en œuvre la revitalisation du secteur riverain et la promotion des Grands Lacs comme destination pour les visiteurs;
- Encouragera l'accès accru du public aux secteurs riverains, dans la mesure du possible, afin d'accroître l'appréciation des collectivités et des touristes à l'égard des Grands Lacs;
- Continuera d'appuyer les festivals riverains, les événements sportifs, les expériences touristiques et les attractions patrimoniales (y compris les ressources du patrimoine bâti, les ressources archéologiques et les paysages ayant une valeur patrimoniale culturelle) qui favorisent l'engagement envers les Grands Lacs et l'utilisation durable du littoral;
- Continuera de promouvoir et d'appuyer les réseaux de sentiers riverains durables qui relient les collectivités et soutiennent les économies locales autour des Grands Lacs grâce à la marche, au cyclisme et à d'autres activités de sentiers;
- Collaborera avec l'industrie touristique des croisières pour tirer parti de ce secteur d'activité sur les Grands Lacs et l'améliorer afin d'attirer davantage de visiteurs et de stimuler l'activité économique.
annexe 12 : les métis et les grands lacs
L'objectif de la présente annexe est de refléter les intérêts et le rôle important des Métis en tant que contributeurs à la restauration, à la protection et à la conservation des Grands Lacs.
Le Canada et l'Ontario collaborent ensemble avec les Métis sur une base de bonne gouvernance dans un large éventail de domaines liés à la protection de l'environnement. L'Accord offre aux Métis, en tant que membres de la collectivité élargie des Grands Lacs, l'occasion de participer et de contribuer aux initiatives de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs. Cette annexe fournira un cadre qui permettra au Canada et à l'Ontario de faire participer les Métis à la mise en œuvre du présent Accord et de tenir compte de leurs connaissances écologiques traditionnelles pour les aider à restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l'écosystème.
Les considérants « Attendu que » du préambule de cet Accord fournissent une référence supplémentaire aux Métis dans le contexte général de cet Accord.
Résultat 1 – Les Métis participent activement aux processus de prise de décisions et prennent des mesures pour restaurer, pour protéger et pour conserver les Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Inviteront les Métis à des réunions annuelles avec les coprésidents du Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario pour discuter des préoccupations relatives aux Grands Lacs, ainsi que les priorités et les mesures planifiées pour atteindre les objectifs de cet Accord;
- En collaboration avec les Métis, élaboreront un processus visant à faire participer les Métis à la prise de décision et à l'application des connaissances écologiques traditionnelles, lorsqu'elles sont offertes, en ce qui concerne l'évaluation de l'état des lacs, l'identification des priorités en matière de science et d'action, et la prise de mesures pour résoudre les problèmes à l'échelle du lac;
- En collaboration avec les Métis, élaboreront et mettront en œuvre un processus visant à faire participer les Métis à la restauration des secteurs préoccupants(SP) et aux décisions relatives au retrait de la liste des utilisations bénéfiques et des SP ou à leur désignation comme SP en cours de restauration, en tenant compte des connaissances écologiques traditionnelles, lorsqu'elles sont offertes;
- Fourniront des possibilités pour les Métis de participer à la mise en œuvre de cet Accord et pour contribuer à la restauration, la protection et la conservation des Grands Lacs;
- Soutiendront le renforcement des capacités des organismes et collectivités des Métis pour mieux aborder les préoccupations relatives aux Grands Lacs, y compris par l’application de connaissances écologiques traditionnelles;
- Encourageront et appuieront les projets et les initiatives des collectivités métisses, y compris ceux en rapport avec les connaissances écologiques traditionnelles, pour aider à restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs au moyen de programmes applicables;
- Inviteront les représentants des Métis à participer aux réunions du comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario.
Résultat 2 – Les avis concernant la consommation de poisson dans les Grands Lacs sont appropriés pour la protection des collectivités métisses.
Le Canada et l’Ontario :
- Participeront avec les Métis intéressés pour réduire l’exposition à des polluants dangereux dans les collectivités Métisses qui comptent sur le poisson des Grands Lacs comme source nutritionnelle importante pour leur alimentation, en s’assurant que leurs habitudes de consommation particulières soient prises en compte, ainsi que les avis élaborés soient appropriés et bien communiqués pour ces collectivités.
annexe 13 : premières nations et les grands lacs
L'objectif de la présente annexe est de refléter les intérêts et le rôle important des Premières Nations en tant que contributeurs à la restauration, à la protection et à la conservation des Grands Lacs.
Le bassin des Grands Lacs compte de nombreuses collectivités des Premières Nations. Les Premières Nations valorisent leur relation spirituelle et culturelle avec les eaux des Grands Lacs. Ils contribuent à la protection de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème des Grands Lacs par l'utilisation et la gestion judicieuses des terres et de l'eau dans leurs collectivités.
Le Canada et l'Ontario collaborent ensemble avec les Premières Nations dans le cadre d'une bonne gouvernance sur un large éventail de questions de protection de l'environnement. L'Accord offre aux Premières nations, en tant que membres de la collectivité élargie des Grands Lacs, l'occasion de participer et de contribuer aux initiatives de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs. Cette annexe fournira un cadre qui permettra au Canada et à l'Ontario de participer avec les Premières nations à la mise en œuvre de l'Accord et de tenir compte des connaissances écologiques traditionnelles pour les aider à restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de leur écosystème.
Les considérants « Attendu que » du préambule de cet Accord fournissent une référence supplémentaire aux Premières Nations dans le contexte général de cet Accord.
Résultat 1 – Les Premières Nations participent activement aux processus de prise de décisions et prennent des mesures pour restaurer, pour protéger et pour conserver les Grands Lacs.
Le Canada et l’Ontario :
- Inviteront les Premières Nations à des réunions annuelles avec les coprésidents du Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario pour discuter des préoccupations relatives aux Grands Lacs, ainsi que les priorités et les mesures planifiées pour atteindre les objectifs de cet Accord;
- En collaboration avec les Premières Nations, élaboreront un processus pour faire participer les Premières Nations à la prise de décision et à l'application des connaissances écologiques traditionnelles, lorsqu'elles sont offertes, en ce qui concerne l'évaluation de l'état des lacs, l'identification des priorités en matière de science et d'action, et la prise de mesures pour résoudre les problèmes à l'échelle du lac;
- En collaboration avec les Premières Nations, élaboreront et mettront en œuvre un processus visant à faire participer les Premières Nations à la restauration des secteurs préoccupants SP) et aux décisions relatives au retrait de la liste des utilisations bénéfiques et des SP ou à leur désignation comme (SP) en cours de restauration, en tenant compte des connaissances écologiques traditionnelles, lorsqu'elles sont offertes;
- Fourniront des possibilités pour les Premières Nations de participer à la mise en œuvre de cet Accord et pour contribuer à la restauration, la protection et la conservation des Grands Lacs;
- Soutiendront le renforcement des capacités des organismes et collectivités des Premières Nations pour mieux aborder les préoccupations relatives aux Grands Lacs, y compris par l’application de connaissances écologiques traditionnelles;
- Encourageront et appuieront les projets et les initiatives des collectivités des Premières Nations, y compris ceux en rapport avec les connaissances écologiques traditionnelles, pour aider à restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs au moyen de programmes applicables;
- Inviteront les représentants des Premières Nations à participer aux réunions du comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario.
Résultat 2 – Les avis concernant la consommation de poisson dans les Grands Lacs sont appropriés pour la protection des collectivités des Premières Nations.
Le Canada et l’Ontario :
- Participeront avec les Premières Nations intéressées pour réduire l’exposition à des polluants dangereux dans les collectivités des Premières Nations qui comptent sur le poisson des Grands Lacs comme source nutritionnelle importante pour leur alimentation, en s’assurant que leurs habitudes de consommation particulières soient prises en compte, ainsi que les avis élaborés soient appropriés et bien communiqués pour ces collectivités.